Un arrêt de Cour de cassation qui devrait sonner l’alarme chez tous les démocrates
La confiance en la justice de son pays tient aujourd’hui de l’acte de foi candide de type religieux plus que d’autre chose. Qui recourt à la justice avec la certitude qu’elle est consciente d’être le dernier rempart du contrat démocratique ? La Cour de cassation vient de rendre le 5 mars 2008 un arrêt dans une affaire déjà évoquée sur Agoravox à deux reprises (1). Les professeurs de l’Éducation nationale, et avec eux tous les démocrates, ont tout intérêt à en prendre la mesure.
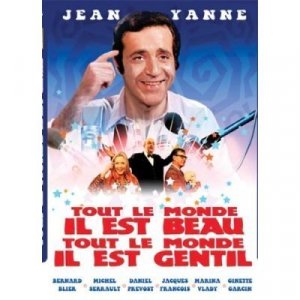
La lettre secrète de dénigrement d’un principal
L’affaire est simple. Un principal de collège avait adressé, en mars 2004, une lettre secrète au président de l’association locale de parents d’élèves FCPE. Il s’y plaignait d’avoir été, au cours d’un conseil de classe de Troisième, accusé par deux mères d’élève de « manipulation et de falsification » au cours d’un conseil d’administration, 6 mois auparavant, dans le but de faire rejeter « démocratiquement » les projets pédagogiques d’un professeur qui comportaient, en travaux pratiques, deux voyages pédagogiques jugés de qualité : l’un en Campanie en était à sa quinzième édition et l’autre à Venise, à sa deuxième. Sur un document, il avait ainsi tenté d’affoler les délégués par un prix de voyage de 4 400 euros par élève quand il était de 360 euros pour huit jours en Campanie (région de Naples) avec deux chauffeurs de car à disposition pour la sécurité. Il avait ensuite imposé le vote secret - ce qui est la règle sans doute en CA, mais rarement appliquée sauf quand on ne veut pas afficher son vote.
Manque de chance, les deux voyages avaient été autorisés, même si c’était à l’arraché à deux ou trois voix près, tandis que le stage de voile et le séjour au ski recueillaient, eux, l’unanimité ou presque. Les délégués des agents de service dans l’anonymat du vote avaient eu le courage de s’opposer à cette destruction programmée : leurs voix avaient fait la différence. La manipulation et la falsification n’étaient donc pas contestables. Et les quatre délégués de la FCPE s’étaient d’ailleurs plaints auprès du principal de ses méthodes dans une lettre.
Le professeur visé n’aurait rien eu à redire sur la lettre secrète du principal au président de parents, si la déléguée incriminée ne la lui avait pas transmise pour qu’il découvrît qu’à ses côtés, le principal le dénigrait aussi allègrement, falsifiant comme à son habitude la relation du conseil de classe.
Une méthode administrative inacceptable
Convaincu que ce type de lettre secrète adressée à une personne étrangère au service ne pouvait être regardée comme une méthode administrative normale, le professeur s’était tourné vers le tribunal civil pour faire reconnaître « une faute personnelle » relevant de la juridiction civile : les griefs qu’un chef d’établissement peut avoir à tort ou à raison contre un professeur, ne sauraient être portés à la connaissance d’un tiers étranger au service. Il existe pour cela une procédure disciplinaire qui garantit les droits de chacun : un rapport circonstancié doit être adressé au recteur d’académie qui décide si un conseil de discipline doit être réuni pour respecter les droits de la défense.
En violant la procédure disciplinaire réglementaire, le principal s’était donc rendu coupable, soutenait le professeur, d’un manquement volontaire aux devoirs de sa charge qu’il ne pouvait ignorer. En outre, si l’intention de nuire était sujet à arguties, l’imprudence, elle, ne pouvait être contestée. Qu’un chef d’établissement dénigre par écrit un professeur devant des parents d’élèves, n’est pas sans conséquences sur la réputation de l’intéressé. Or, selon l’article 1383, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». En adressant cette lettre de dénigrement, le principal, imprudent, ne pouvait pas, en effet, s’assurer qu’elle ne serait pas divulguée. Ce qui s’est effectivement produit. La jurisprudence de « l’acte détachable du service » est, d’autre part, plus que centenaire : elle veille à ce que le pouvoir administratif ne soit pas mis au service de règlements de comptes personnels. L’affaire paraissait entendue.
Une lettre secrète jugée exempte d’ « intention personnelle et déloyale »
- En première instance
Eh bien pas du tout ! D’abord, le recteur a demandé au préfet qui a demandé au procureur de demander au juge de s’estimer incompétent, car selon eux, il ne s’agissait pas d’ « un acte détachable du service », mais d’ « un acte de service » relevant de la juridiction administrative : autrement dit, cette lettre secrète de dénigrement était une méthode administrative parfaitement réglementaire ! Et le tribunal de grande instance s’est rangé de cet avis le 14 octobre 2004 : il ne nie pas le dénigrement puisqu’il constate que le professeur « n’est stigmatisé que du point de vue de l’exercice de ses fonctions » ! Mais il ne relève « la présence d’aucune intention malveillante et/ou de préoccupations privées sans rapport avec la mission de service public de nature à rendre inconcevable l’exercice de cette mission ».
Il est à noter que, parallèlement, le même professeur a obtenu l’annulation d’un blâme par le tribunal administratif pour « inexistence matérielle de motif et violation de procédure » : les motifs donnés par le même principal et repris par le recteur étaient imaginaires ! Le rapprochement des deux affaires suffit, on le voit, à éclairer l’absence totale d’intention malveillante chez ce principal, comme le soutient le tribunal.
- En appel
Or, interjetant appel, le professeur va se heurter, le 21 novembre 2006, à une confirmation encore plus évidente de la normalité administrative dans laquelle entre tout naturellement cette lettre secrète de dénigrement. Si la cour concède tout de même qu’elle constitue une « maladresse » - l’adresse aurait sans doute été qu’elle fût restée secrète - elle affirme qu’ « il n’est pas démontré que cette lettre a été diffusée dans le secret espoir de la voir diffusée, la diffusion étant le fait maladroit de son destinataire et non de son émetteur ».
On goûtera l’humour de la cour quand il s’agit d’expliquer que l’auteur d’une lettre secrète ne souhaite surtout pas qu’elle soit connue. On apprécie moins que l’imprudence, retenue par le Code civil, soit ignorée de la cour comme motif suffisant pour imputer un dommage à son auteur : encore une fois, le principal ne pouvait s’assurer que la lettre ne fût pas diffusée avec les conséquences dommageables qu’on imagine pour la victime. Ceci du moins est prouvé. Mais la cour préfère fouiller les reins et les cœurs et ne parler que du « secret espoir »... impossible à prouver ! Et pour faire bonne mesure, elle ajoute qu’elle ne voit « (aucune) intention personnelle et déloyale du principal à l’encontre (du professeur) ».
Il est connu, en effet, que tout le bien que l’on pense de quelqu’un est en général gardé secret et le mal, volontiers crié sur les toits. Pour sa peine, en tout cas, le professeur s’est vu infliger les dépens et 2 000 euros à verser à son bienfaiteur.
La Cour de cassation confirme
Atterré de voir qu’on pût ruser à ce point avec le droit, le professeur s’est pourvu en cassation en s’offrant les services onéreux d’un de ces membres du cercle aristocratique restreint des avocats seuls habilités à plaider devant la cour suprême. Un seul moyen de cassation était avancé. La cour d’appel « (avait) violé ensemble la loi des 16-24 août 1790 (2) et l’article 1382 et 1383 du Code civil en ne reconnaissant pas le manquement volontaire et inexcusable du principal à ses obligations d’ordre professionnel et déontologique s’analysant en une faute personnelle détachable de l’exercice normal de ses fonctions ».
La Cour de cassation vient de dire, par son arrêt du 5 mars 2008, que tel n’est pas son avis. Les attendus sont très brefs. Il y en a trois. Les deux premiers se contentent d’évoquer la procédure suivie. Voici le troisième : « Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, fait ressortir que le principal avait agi à l’occasion de ses fonctions, dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’établissement dont il avait la charge, et souverainement retenu tant l’absence d’intention malveillante de sa part que le fait qu’il n’était pas démontré que la lettre ait été rédigée en vue de la constitution clandestine d’un dossier disciplinaire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé. »
La lettre secrète est à nouveau considérée comme exempte d’ « intention malveillante ». Quant au moyen de cassation avancé, il n’y est même pas répondu par la cour : elle l’ignore tout simplement, ce qui la dispense d’argumenter pour le réfuter. Elle préfère se retrancher derrière la souveraineté de la cour d’appel. Et pour faire, elle aussi, bonne mesure, elle condamne à nouveau le professeur aux dépens et à verser à nouveau 2 000 euros à son bienfaiteur. Avis à qui osera à l’avenir contester la légitimité d’une méthode administrative aussi régulière !
La défense des victimes méthodiquement entravée
Ainsi, une lettre secrète de dénigrement adressée par un chef d’établissement à des parents d’élèves, sans que nul n’en sache rien - sauf accident - devient-elle une méthode administrative homologuée par la Cour de cassation qui régit la morale publique française. Les chefs d’établissement pourront s’en donner à cœur joie à l’insu de leurs victimes, ou si elles en ont vent, sans dommage pour eux. La procédure disciplinaire ne les lie plus : avant de saisir le recteur des griefs qu’ils ont contre un professeur, ils pourront secrètement en informer les parents d’élèves pour solliciter au besoin des ragots et en nourrir leurs rapports, en toute liberté et impunité.
Si l’on veut prendre la mesure de la gravité de cet arrêt, il convient de le replacer dans le contexte d’atteintes aux libertés où il s’inscrit.
1- Déjà, depuis la loi du 12 avril 2000, les lettres de délation sont interdites de communication à leurs victimes. La loi protège le délateur : c’est le résultat d’une destruction de la loi du 17 juillet 1978 opérée discrètement.
2- Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2001, le délit de dénonciation calomnieuse est une procédure impossible à engager avec la moindre chance de succès : la victime doit prouver en effet que son dénonciateur savait que les faits dénoncés étaient faux au moment de la dénonciation ! On retrouve la même logique de pensée que dans l’arrêt du 5 mars 2008 : on oblige la victime à prouver une intention impossible à prouver sans compteur Geiger mental, au lieu de s’en tenir à l’imprudence que prouve la conduite consistant à dénoncer imprudemment des faits qui sont faux !
3- Divers jugements montrent, en outre, que la loi du 17 janvier 2002 sur le harcèlement moral est quasiment impossible, elle aussi, à mettre en œuvre avec succès, sauf exception.
4- Enfin la protection statutaire dont la loi fait une obligation à la collectivité publique quand un fonctionnaire est attaqué à l’occasion de ses fonctions, est quasi systématiquement refusée et des jugements récents montrent que la justice administrative qui, pendant un temps, annulait régulièrement ces refus à la demande des victimes, les confirme désormais !
Quelle défense reste-t-il à un professeur calomnié, diffamé ou dénigré, secrètement ou ouvertement avec comme chef d’orchestre son propre chef d’établissement, relayé par l’inspecteur d’académie et le recteur, le ministre couvrant par principe les échelons inférieurs ? Aucune, puisque le terrain de la défense des droits de la personne est déserté depuis 25 ans par les syndicats et que la justice n’est plus qu’une chimère. Il faut, aujourd’hui, une foi chevillée au corps qui frise l’inconscience pour s’aventurer dans ce métier dont on a vu récemment, avec l’affaire de Mme Karen-Montet-Toutain, qu’on peut en rester traumatisé à vie, quand on a par chance survécu, sans qu’il en incombe la moindre responsabilité à une administration de l’Éducation nationale au-dessus de tout souçon et hors de portée de toute procédure. Paul Villach
_________________
(1) « Un principal peut-il stigmatiser secrètement un professeur devant une association de parents d’élèves ? » 13 septembre 2006. - « Lettre secrète de dénigrement, un acte administratif loyal ? » 29 novembre 2006.
(2) Article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, sous peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »
Le moyen de cassation fait donc valoir qu’en considérant comme normal le manquement volontaire d’un principal aux devoirs de sa charge par la violation de la procédure disciplinaire que constitue l’information préalable d’un tiers étranger au service, avant tout rapport au recteur, la cour d’appel n’a pas respecté la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, régie par la loi ci-dessus, en exonérant le principal d’une faute personnelle qui regarde la juridiction civile et violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.
49 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









