Le cinéma : un espéranto triomphant
Le cinéma et l’espéranto apparaissent simultanément avec la modestie des inventeurs du premier et l’ambition d’universalité du second. Les évolutions ne se passeront pas comme prévu et ces inventions vont voir leurs destins s’inverser rapidement.

A quelques années d’intervalle, deux inventions voient le jour en cette fin de XIXe siècle qui foisonne d’expérimentations. L’espéranto avec l’ambition de mettre en place un langage universel et le cinéma auquel personne, y compris ses inventeurs, ne croit trop et qui se situe entre l’outil scientifique et l’attraction foraine. Aujourd’hui, moins de deux millions de personnes dans le monde maîtrisent l’espéranto alors que chaque année on vend 1,5 milliard de places de cinéma aux Etats-Unis, 5 milliards en Inde et qu’on produit 15 000 films sur la planète. Les films transitent souvent d’un pays à l’autre, davantage d’Ouest en Est et du Nord vers le Sud alors que, paradoxalement, l’Extrême-Orient possède la plus grosse production cinématographique mondiale (450 films produits aux Philippines par an, 620 en Inde, 385 seulement aux Etats-Unis).
Revenons à l’espéranto. Ludwik Lejzer Zamenhof, en pleine révolution scientifique, souhaite faciliter la communication, mais surtout remarque que les inventeurs et autres « savants » comprennent l’intérêt de connaître ce que concoctent leurs voisins de cultures différentes. On commence à réaliser que l’inventeur, seul dans son laboratoire, ne pèse pas lourd face à la communauté internationale. Le français avait joué le rôle de langue commune dans le monde diplomatique, aristocratique et plus généralement culturel, mais il se révèle fort complexe à l’apprentissage comme à l’usage, mal adapté à un langage concis et précis à la fois dont la science a besoin pour s’épanouir. L’espéranto est un fabuleux projet : une langue construite de toutes pièces (c’est une première, son auteur passe dix ans à la mettre en place) qui fonctionne assez simplement avec un système grammatical d’agglutination et qui, bien sûr, ne comporte pas d’exceptions. La langue parfaite si l’on se réfère à la définition : « système d’expression et de communication commun à un groupe social ». Sauf que dans ce cas précis, le groupe social est l’humanité toute entière. Outre la simplification, l’espéranto comporte l’avantage de ne favoriser aucune culture puisqu’il va puiser ses sources dans toutes les origines linguistiques (essentiellement indoeuropéenes toutefois).
« Psychologiquement, l’espéranto est la langue étrangère la moins frustrante à manier. Tous ceux qui en ont l’expérience le confirment. En effet, l’esprit humain est cohérent. L’enfant qui dit fleurier pour "fleuriste" et journalier pour "journaliste" a compris ce qu’avait de commun la série fermier, poissonnier, serrurier, et il crée une règle là où la plupart des langues baignent dans le désordre », Claude Piron Action et pensée 1991, n° 19, p 51-79.
Force est de constater que l’espéranto n’a pas connu le succès escompté. Les causes en sont multiples et la principale semble tenir à la difficulté de séparer langue et culture.
Peut-on
parler de langage (et pas de langue) cinématographique ? Si l’on se
réfère à la définition du langage : « tout système de signes permettant
la communication », oui et même davantage. En affirmant cela, on ne
peut que constater l’universalité de ce langage. A force de baigner
dans un monde télévisuel et iconique, on ne réalise plus les
conventions que le cinéma a engendrées, en douceur, et qui sont
aujourd’hui admises par tous et jamais remises en question. Et pourtant
dans un film :
on change brutalement de lieu (à chaque séquence), de temps (retour arrière flash-back,
futur, rêve, etc.), de point de vue (à chaque plan) et même d’époque
sans que personne ne s’en étonne. Le plan d’un personnage, les yeux dans
le lointain, suivi d’un paysage suggère immanquablement que le
personnage admire ce panorama-là. On passe de « l’objectif » (point de
vue du spectateur) au « subjectif » (point de vue de l’acteur) sans
crier gare et tout le monde parvient à suivre cette pirouette pourtant
tellement artificielle. Que dire du champ contre-champ ? Il serait
fastidieux de s’attarder ici sur de nombreux exemples, mais retenons que
le cinéma se trouve chargé de codes (Cf. Christian Metz Langage et cinéma Larousse
1971) que le monde entier a assimilés sans se poser davantage de
questions. En cherchant bien, on ne trouve pas aujourd’hui un seul type
de cinéma qui ne respecterait pas ces conventions-là devenues communes,
sans pourtant que personne n’ait décidé autoritairement de rien.
Christian Metz parle d’espéranto pour le cinéma muet, un espéranto qui
connaîtra, lui, un fantastique succès, bien au-delà de l’attente des
plus optimistes inventeurs.
Que doit-on conclure de l’échec de l’espéranto et du succès du cinéma ? Que l’Occident a imposé un mode culturel au monde entier sans connaître la moindre résistance du simple fait de la nouveauté ? Que l’homme possède une faculté d’adaptation exceptionnelle lorsque rien ne vient contrarier sa marche, mais qu’il possède une force énorme de résistance si son esprit a déjà été formaté à une autre pratique analogue (une explication à l’échec de l’espéranto) ? Qu’il reste préférable de ne rien tenter d’imposer quant aux cultures qui se forgent d’elles-mêmes ? Qu’il vaut mieux ne pas rechercher l’universalité à tout prix ? Je vous laisse le choix des arguments et reste ouvert pour en lire d’autres dans un débat constructif.
Illustration : Les frères Lumière (haut), Ludwik Lejzer Zamenhof (bas)
Documents joints à cet article
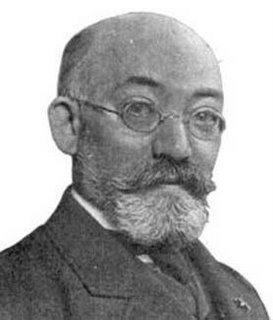
90 réactions à cet article
-
Bonjour Philipakos,
Le titre de ton article m’a intrigué. Bien amené le sujet qui te préoccupe.
C’est un peu comme l’évolution : il y a des choses qui passent et d’autres qui cassent. Dure loi de la nature.
Le cinéma était nouveau à 100%. Les images, tout à coup, passaient au mouvement.
L’esperanto n’était qu’une suite, une réaction à la cacophonie des langues et de toutes ses expressions idiomatiques.
L’ordre et la méthode ont été recherchés. C’est une réussite. Mais il y avait concurrence avec le vécu de milliers d’années, des habitudes incrustées et transmises de génération en génération.
Pourquoi ne parlons-nous pas en Indo Européen ? Je trouve que c’est une bonne question.
En fait, le problème de l’esperanto, c’est, cette fois, d’avoir raison trop tard.
J’ai jeté quelques bons coups d’oeil sur l’esperanto. Etant très pragmatique, je le dis, c’est « génial ».
Facile à apprendre, construit sur des bases bien échafaudées. Pas de « conneries » qui sont venus par le mélange. Le mélange est bon, mais pour être compris partout, il vaut mieux savoir mettre de l’ordre pour avoir une chance d’être utilisé par tous. C’est du pragmatisme et pas de l’assimilation qu’il faudrait. J’ai EK installé sur mon PC. Je voudrais l’utiliser plus souvent.
Et si on créait sur Agoravox, une section esperanto ? Ce serait certainement « in »
-
Pour l’esperanto, Philippakos oublie de souligner que ce projet de langue universelle avait dans l’esprit de son auteur une portée qui allait bien au-delà de la linguistique accessible à tous. Le nom-même de cette création désigne une personne qui espère, c’est très symptômatique. Zamenhof voulait un grand ordre moral nouveau, une réconciliation mondiale des peuples autour d’une égalité fondée sur une langue. Je trouve cela très naïf et je pense que c’est aussi cette philosophie-là qui a fait capoter le projet. Le cinéma était libre de toute intention, et surtout pas moralisateur : c’est en cela que tient son essor aussi. En vertu de quoi les peuples du monde auraient-ils accepté « l’ordre juste » prôné par un seul, sous prétexte qu’il savait manier quelques langues et avait passé 10 ans à en créer une de toutes pièces ? Effectivement, le substrat culturel propre à chaque pays est une formidable résistance déjà à l’apprentissage d’une langue artificielle. Quand on y ajoute la volonté philosophico-égalitaire d’un seul homme, il est évident que cela ne peut marcher. Cependant, à l’heure actuelle, quelles sont les motivations de ceux qui maintiennent l’esperanto sous perfusion ? Je doute qu’il y ait encore une trace humanitaire derrière mais cela ne fait pas mieux prendre la sauce pour autant. Il est encore plus tard que ne le pense L’Enfoiré !
-
Renseignements pris, et aussi surprenant que cela paraisse, l’indoeuropéen n’est pas une langue (au sens actuel) mais le résultat d’une recherche étymologique qui aboutit à une série de supppositions, une construction intellectuelle. Ce n’est pas une réalité linguistique. La langue connue la plus proche de cet indoeuropéen serait le sanscrit. Pour l’espéranto, il y a bien l’anglais simplifié qui tend à jouer ce rôle-là (dans certains colloques on sépare le canal audio « anglais d’angleterre » du canal « anglais pour étrangers » qui est une simplification qui « espère » être comprise par tous)mais là encore on peut se plaindre d’un impérialisme culturel.
-
Satyre satirique
L’Eo est à peine plus artificiel que le français, voir mon commentaire plus loin.
Vous dites : naïf ; mais penser que la lenteur de la progression de l’Eo provient de ce que son fondateur il y a 120 ans avait envisagé de lancer en parallèle une philospohie humaniste, c’est très naïf ! D’autant que Zamenhof lui-même a vite perçu le risque et s’est limité à sa langue internationale.
-
Renseignements pris, et aussi surprenant que cela paraisse, l’indoeuropéen n’est pas une langue mais l’aboutissement de recherches étymologiques. Une sorte de construction intellectuelle qui n’a pas de réalité linguistique. La langue la plus proche serait le sanscrit. Pour l’espéranto, il y a bien l’anglais simplifié qui tend à jouer ce rôle-là. On trouve dans certains colloques un canal audio « anglais d’Angleterre » et un autre « anglais pour étrangers »,un anglais assez basique qui tente d’être compris par tous. Mais on peut parler, comme pour le cinéma, d’un impérialisme culturel.
-
Merci pour ta recherche Philippakos,
« l’indoeuropéen n’est pas une langue... le sanscrit, la plus proche »
>>> Le sanscrit, oui, donc. Et pourtant, même lui n’est pas resté à bord.
>>>Pour le reste, je te dirais que tu as utilisé le mot « anglais » par 4 fois. Là tu vas te faire eng... par Krokodilo. Je plaisante, bien sûr.

« impérialisme culturel. »
>>> C’est un des grands reproches que l’on peut faire à cette langue.

-
Saluton, L’Enfoiré, Moi aussi je peux le dire : anglais, anglais, anglais, anglais ! Et je n’ai même pas eu de nausées !
-
A cette période où le 92e congrès mondial d’espérantophones vient de se dérouler à Yokohama, sans interprètes, avec la participation d’env. 2000 personnes en provenance d’une soixantaine de pays, il me paraît plus qu’incorrect de déclarer que l’espéranto, la langue internationale n’a pas réussie...
Ces déclarations témoignent bien de l’ignorance de leur auteur (en tout cas, c’est ce que j’aimerais croire...)
http://www.kontakto.info/Un_congres_mondial_sans_interpretes_a_Yokohama.htm l

.
-
L’espéranto reste une belle et grande idée, mais une langue universelle parlée par seulement deux millions de personnes, utilisée principalement pour les congrès d’espéranto (dont vous parlez), il me semble que, plus d’un siècle après, on soit loin des buts espérés à l’époque de la création. Cela dit, peut être que l’avenir sera radieux et que cette langue sera utilisée plus fréquemment. Pour l’instant, et si mes chiffres sont exacts, cela fait une personne sur 3000, ce qui reste assez peu tout de même.
-
Avez-vous réalisé qu’il est tout aussi difficile d’estimer le nombre de gens qui parlent anglais ? Car parler anglais, cela ne veur rien dire, ou plutôt ça recouvre un éventail de niveaux infiniment variés, de quelques bribes au « fluent english », voire au quasi natif. Je ne prétends pas que les locuteurs d’Eo soient cinq ou dix millions, je n’en ai aucune idée, simplement que pour l’anglais, personne n’en sait rien non plus ! Et j’ajouterai qu’à mon avis, les dirigeants ne veulent pas le savoir ! Plus de 7 ans après la mise au point du CECRL, une échelle consensuelle de niveau en langue reconnue par tous les pays européens, aucune étude n’a été faite pour connaître le niveau réel en anglais de sdifférnets pays européens... On préfère gloser sur les sondages d’Eurobaromètre à qui on fait dire ce qu’on veut.
-
Oui mais le seul fait que l’Espéranto ait survécu, qu’il se soit développé dans un climat de scepticisme ambiant, voire de persécutions (sous Staline et Hitler notamment), alors que sur les centaines de langues construites très peu subsistent longtemps, ce seul fait est déjà un succès.
Et puis, cette langue construite « fonctionne », ça aussi c’est une prouesse : une langue qui « marche », cela ne s’invente pas comme ça !
Peut-être qu’il faut attendre que les injustices dûes à la domination de l’anglais soient assez criantes et visibles par tous pour qu’une réflexion et une coordination politiques s’opèrent autour de l’Espéranto ?
-
Bel article où le rapprochement en l’espéranto et le cinéma n’est pas évident en première approche. Mais le raccord fonctionne. Je m’étonnait il y a quelques jours du fait qu’on mette des sous titres sous les films mais que les expressions sur le visage des acteurs lui n’avait pas besoin d’être traduit. Et donc cette expression des visages et du corps s’internationnalise plus vite que les langues où est elle un langage fondamental ?
-
Votre commentaire met le doigt sur le spécieux du propos initial, au demeurant bien documenté (peut-être un peu pessimiste sur les 2 millions de locuteurs de l’espéranto). En effet, le cinéma n’est pas un langage. C’est un moyen de communication, comme le furent les fastes de la cour de Louis XIV, s’appuyant successivement sur la danse, la musique, le théâtre, la religion. A preuve, qui pourrait faire un sujet filmé de la dissertation de l’enfoiré ? Si vraiment l’auteur de ce texte souhaite le voir débattu internationalement, à défaut d’universellement, le mieux est qu’il le rédige effectivement en espéranto. Les (un peu plus de ..) 2 millions d’espérantistes, présents pratiquement dans tous les pays, assureront cette discussion internationale. Un film, lui, en s’appuyant sur les attitudes, mimiques, etc (qui sont pour la plupart innées et communes à tous les hommes, diverses études l’ont montré) peut effectivement prétendre à l’universalité. Do, se Agoravox volus internaciiĝi , ĝi fakte kreu esperantan retdiskuton. Mi pretas ! (avec simplement 50 heures d’espéranto).
-
Pourquoi pas en espéranto (j’ai toutefois déjà le problème de parler la langue du pays où je vis, la Grèce) mais j’ai bien fait la différence entre langue et langage. Le cinéma n’est pas une langue en effet, bien que certains aient tenté de faire le rapprochement avec le plan pour le mot, la séquence pour la phrase, etc. Un langage, en revanche, avec la définition que j’ai donnée paraît mieux adapté... comme on parle du langage des signes. J’ai voulu mettre l’accent sur l’importance des codes au cinéma, qu’on ne perçoit pas (plus) mais qui sont bien présents et, sans le moindre doute, universels. L’espéranto m’a semblé être un formidable défi, celui de construire une langue sans culture préexistante. L’enfoiré dit que c’est très satisfaisant pour l’esprit, d’autres articles que j’ai pu lire vont dans le même sens. Il y a lieu (mais je suppose que bien d’autres l’ont déjà fait) de se demander pourquoi il n’a pas connu la destinée auquel il était promis. Vous avez sûrement plus d’idées que moi sur le problème (je viens, juste à l’instant, de lire les deux derniers commentaires qui sont arrivés pendant que je rédigeais). J’ai lu les raisons développées par Claude Piron, il y a sûrement d’autres propositions que j’ignore. Merci à Krokodilo et à Apro pour la richesse de leurs commentaires. Difficile, il est vrai, de parler d’échec si ce n’est que l’espéranto n’a pas atteint le but de son universalité. Un détail technique : il semble, comme presque toujours, plus facile de maîtriser le sens version que le sens thème (surtout avec une connaissance du grec et du latin). Reste pour moi la question de la prononciation : le u se prononce-t-il à la française ou comme dans la majorité des langues « ou ». Pour conclure une dernière question : pensez-vous que l’histoire aille dans le sens de son développement et comment supprimer les barrières qui ont freiné son épanouissement ?
-
Le « u » se prononce effectivement « ou ». Zamenhof, avec sa géniale intution linguistique, n’aurait jamais choisi une prononciation spécifique à un pays.
« pensez-vous que l’histoire aille dans le sens de son développement et comment supprimer les barrières qui ont freiné son épanouissement ? »
Je n’ai pas besoin de penser : il y a des signes objectifs et vérifiables des progrès de l’Eo en France, alors que c’est un des pays les plus réfractaires sur le plan officiel, même si il a souvent donné des espérantistes très actifs. Par exemple :
- Le Monde diplomatique sort une version en ligne en Eo depuis des années. http://eo.mondediplo.com/
- la ville de Montpellier a son site officiel en neuf langues dont l’Eo http://eo.montpellier.fr/18-accueil.htm (Ces résultats sont souvent dûs aux efforts réguliers d’un groupe local.) Même si les grands médias nationaux continuent leur boycott scandaleux (au nom de quels critères moraux s’arrogent-ils ce droit ?), les journaux locaux et les médias en ligne sont beaucoup plus réceptifs. Les journaux locaux rapportent les rencontres locales et les congrès natioanux, et les médias en ligne commencent à citer l’Eo sans les habituels clichés condescendants ou ironiques : récemment, « Courrier international », « Marianne » en ligne il ya quelques mois. Le magazine Le Taurillon a fait un article fouillé et honnête, suivi d’un débat. Et ces magazines en ligne abordent parfois un autre sujet boycotté par les médias traditionnels : l’hégémonie d el’anglais dans l’Union européenne. Le blog du journaliste Quatremer est aussi un de ceux qui en parlent, avec beaucoup de détails puisés à Bruxelles même...
- Agora vox, naturellement, ce mélange nouveau d’articles et de forum, a permis divers articles et débats passionnés.
- Wikipedia, géniale encyclopédie en ligne gratuite et collective, une révolution qui nous surprendra encore davantage à mon avis par ses potentialités. Les espérantistes ne s’y sont pas trompés et y ont fait des articles en grand nombre.
- Petit à petit, nous ne sommes plus systématiquement considérés comme des farfelus ou des loufdingues : même des sites sérieux comme ceux de la défense de la langue française nous laissent en discuter de temps en temps sur leurs forums, ou laissent un article qui parle de l’Eo. C’est anecdotique, mais significatif d’un changement d’attitude à l’égard de cette langue.A l’étranger, http://lecourrier.vnagency.com.vn/default.asp?CATEGORY_ID=16&NEWSPAPER_ID=39&TOPIC_ID=50&REPLY_ID=30804 A remarquer la façon tranquille dont l’auteur parle de l’Eo, sans cette espèce de gêne qu’on devine parfois en France car le journaliste ne sait pas trop quoi penser de cette drôle de bête linguistique. Et je crois que le Courrier du Vietnam est subventionné par l’Ambassade de France !
-
Pour vous familiariser avec la prononciation de l’espéranto, je vous propose de lire et d’écouter en même temps l’allocution de Claude Piron, prononcée à l’occasion du centenaire du 1er congrès mondial d’espéranto : http://www.claude-piron.ch/Claude_Piron_Bulonja_prelego_2005.html - ... de nouveau un congrès, mais je peux vous confirmer que cette langue inter-ethnique est bien utilisée en dehors de ces événements annuels, à d’autres occasions, réunions, fêtes internationales, etc. Moi même, j’utilise l’espéranto tous les jours dans mes contact avec des amis, de connaissances du monde entier, par l’Internet.
Il y a des émissions radio en espéranto (ondes courtes et Internet) et beaucoup d’espérantophones mettent à disposition des internautes des émissions enregistrées, « podcasts » aussi.
Pour vous distraire aussi un peu, je vous propose de visiter cette page qui vous conduira jusqu’à la page des artistes de l’Océan indien (Ile Maurice, Madagascar), qui chantent en espéranto : http://www.studio-pro.ch/esperanto-muziko.html
Amusez-vous bien et bonne nuit ! .
-
Tout est relatif ! L’on peut certes penser que 2 millions de personnes qui parleraient l’espéranto est un nombre peu important, mais c’est déjà énorme puisqu’on ne pourra jamais toutes les contacter. C’est déjà impossible de lire tout ce que est écrit dans cette langue. Tout dépend de ce qu’on veut en faire. Par exemple, j’ai appris l’anglais pendant 4 ans, mais je m’en suis servi que trois fois en quarante ans, alors que j’utilise quotidiennement l’espéranto depuis plus de 30 ans avec des personnes de tous les continents.
Par ailleurs, vu tous les obstacles que doit surmonter cette langue, l’on peut dire, au contraire, qu’elle s’est très bien développée après 120 ans. Comparez avec les chiffres arabes qui ont mis 3 siècles pour se répandre ! C’est en 1202 que Leonardo Fibonacii, dit Leonardo de Pise, publie son livre « Liber Abaci » dans lequel, grâce aux chiffre arabes, il développe une méthode de calcul qui, avec exactitude et rapidité, permettait de réaliser les quatre opérations fondamentales : addition, soustraction, multiplication, division. C’était une révolution dans la façon de calculer, mais l’accueil fut glacial. Les universités en refusèrent l’usage, tout comme l’Eglise, et les marchands s’obstinèrent à utiliser les chiffres latins. Pourtant essayez de multiplier, ou de diviser, MMMDCCXVLIV par XVVI ... L’emploi des chiffres arabes ne commença à se répandre qu’au 16e siècle, après quelque 300 années !
L’on pourrait aussi comparer l’évolution de l’espéranto avec celle du système métrique, qui a mis des décennies à se faire adopter, alors qu’il facilite grandement les calculs dans bien des domaines. Pourtant, de nos jours nos aviateurs persistent à utiliser leurs pieds, nos marins en sont restés à leurs noeuds et à leurs milles nautiques, et nos robinetiers utilisent toujours leurs pouces.
Je pense que l’Homme est souvent un masochiste qui adore se compliquer inutilement la vie dans bien des domaines, entre autres dans celui de la communication !
-
Le parallèle est très intéressant. J’ai tout d’abord tiqué comme R. Leleu dans son commentaire, en me disant que comparer un outil et une langue n’a pas de sens. Pourtant, par la caméra, chacun a pu projeter son imaginaire, sa culture ; l’espéranto, de son côté, se veut langue-outil, langue auxiliaire interculturelle grâce à laquelle les cultures pourraient mieux discuter entre elles. Finalement, je trouve l’analogie assez pertinente. Alors, comment expliquer l’évolution différente ?
Tout simplement parce que l’immense majorité des gens ne font pas de films, ils vont les voir ! Le nombre de locuteurs d’espéranto devrait être comparé au nombre de créateurs de films, car chacun d’eux a dû faire un effort comparable à celui du cinéaste, en apprenant la langue, alors que les spectateurs sont passifs.
Mais naturellement, le principal obstacle reste le refus des politiques, le poids des puissances du commerce au sens large, le boycott des médias qui roulent pour l’anglais, le côté radicalement nouveau, révolutionnaire d’une langue construite, dont l’idée est ancienne mais dont la naissance et la vie réelle sont trop progressistes pour être facilement acceptées, car nous sommes fondamentalement conservateurs (ce que vous évoquez dans votre conclusion), avec un goût pour la stabilité, à l’exception de l’adolescence et des jeunes adultes. Les nombres décimaux ont mis plusieurs siècles à être acceptés.
Sinon, je me permets de corriger ou de préciser quelques notions :
« L’espéranto est un fabuleux projet : une langue construite de toutes pièces (c’est une première, son auteur passe dix ans à la mettre en place) »
Beaucoup de lecteurs, en lisant « construite de toutes pièces », ce qui est techniquement exact, comprendront artificielle. Or, il est important de préciser que le vocabulaire est millénaire, car puisé dans certaines des langues très répandues en Europe à l’époque. La grammaire est construite, de façon à être la plus simple et la plus internationale possible, là encore en puisant des idées dans diverses langues. C’est cette géniale synthèse qui en fait toute son originalité.
« La langue parfaite si l’on se réfère à la définition : « système d’expression et de communication commun à un groupe social ». Sauf que dans ce cas précis, le groupe social est l’humanité toute entière. Outre la simplification, l’espéranto comporte l’avantage de ne favoriser aucune culture puisqu’il va puiser ses sources dans toutes les origines linguistiques (essentiellement indoeuropéenes toutefois). »
L’espéranto n’est pas parfait car, comme vous l’avez dit, le vocabulaire est essentiellement indo-européen, mais il faut remarquer que les étymologies latines et grecques sont celles qui ont le plus essaimé dans le monde entier, pour des raisons historiques ; ainsi, le premier film que j’ai vu à l’école, « Daktari », signifie docteur en swahili je crois, et le japonais actuel comprend plusieurs dizaines de milliers de mots anglais, il me semble. Donc, plutôt que langue parfaite, ce qui vaudrait aux espérantistes bon nombre d’accusations de prétention ou de mégalomanie, mieux vaut dire meilleure langue auxiliaire construite disponible actuellement ! Et plus exactement, la seule qui a fait la preuve de son efficacité, la seule reconnue, la seule à vivre réellement.
Pour la neutralité et la facilité, rien à redire. Mais je crois qu’on n’insiste jamais assez sur la facilité, car le dogmatisme actuel masque un fait capital : l’apprentissage d’une langue est un énorme travail, et maintenir son niveau tout autant. L’anglais comme lingua franca, de l’école primaire (quasiment obligatoire) au bac, voire dans les écoles d’ingénieur et les universités, c’est la solution élitiste à la tour de Babel, à la communication dans l’Union européenne, alors que l’espéranto, c’est la démocratie, un outil simple pour le plus grand nombre, c’est d’ailleurs une des raisons du refus des gouvernements de le prendre en compte.
Enfin, simple détail sémantique, l ‘expression « langue universelle » réveille souvent des fantasmes et des peurs irrationnelles d’écrasement des langues nationales, ce qui est absurde, aussi je préfère utiliser langue internationale, langue construite, langue auxiliaire, langue interculturelle, langue-pont,etc. !
Ah si ! J’oubliais le point principal ! En fait, personne ne peut parler de l’échec de l’espéranto. Tout simplement parce que c’est un phénomène unique dans l’histoire de l’humanité (si, si), première langue construite à s’être développée, à être reconnue par les instances internationales, à vivre comme toute autre langue, et ce depuis un siècle. Personne n’a donc d’élément de comparaison pour savoir à quelle vitesse une invention si géniale, mais si révolutionnaire, peut ou non diffuser plus largement ! Tout au plus peut-on dire que beaucoup espéraient une diffusion plus rapide, mais la France, entre autres, a voté contre à la Société des nations... et continue de freiner des quatre fers.
Alors, si en ce mois d’août, il y a des jeunes qui sont devant leur écran (ex-moniteur) lançons-leur un appel.
Soyez curieux, soyez audacieux : apprenez l’Eo ! Soyez politiquement incorrects : apprenez la seule langue interdite en France à l’école ! Soyez anticonformistes : refusez que l’anglais devienne la lingua franca de l’Union européenne ! Reprenez le flambeau de vos aînés : sachez que certains de vos instits et professeurs aiment et soutiennent l’Eo en secret ! L’avenir de l’Eo, c’est vous !
-
Je rebondis rapidement sur les deux commentaires d’Apro et Krokodilo. Désolée pour la pensée parfois décousue mas je note en vrac les idées qui me viennent à l’esprit.
 D’abord, suite au vibrant appel de Krokodilo, je suis allée chercher sur mon iTunes les Podcasts en esperanto pour avoir une idée de la prononciation qu’évoquait Philippakos. J’en ai téléchargé deux, un émis par la Pologne, l’autre émis par l’Angleterre. Je ne peux m’empêcher de constater que la prononciation n’est pas du tout la même, et qu’elle ne tient pas seulement à un accent polonais ou autre ! Je n’y connais rien en esperanto mais pratique des langues étrangères suffisamment différentes les unes des autres pour repérer ce qui est de l’ordre d’un simple roulement de -r- ou ce qui va au-delà, avec une intonation (fondamentale dans certaines langues où si on ne marque pas les accents toniques, on s’expose à une incompréhension quasi totale), une dynamique de la phrase qui ne sera pas la même selon la nationalité de la personne, et, malgré tout, l’accent aussi, qui joue un grand rôle : quelqu’un à côté de moi vient de me dire, en écoutant la bande audio « c’est prononcé par une Chinoise », alors que c’était la « version » polonaise ! Je pose donc la question en totue naïveté : l’esperanto est-il fait pour être une langue orale ou un outil de communication écrit ? J’ai des doutes sur son efficacité internationale (et non interculturelle, qui m’a fait bondir : l’esperanto relève de tout ce qu’on veut sauf du l’interculturel ! Multi- ou poly- mais pas inter-, non !) ; bien sûr, les adeptes vont me dire « ah, au dernier congrès d’esperanto, j’ai tout compris de ce que disait mon voisin arabe » mais n’est-ce pas le lieu-même de rencontre des puristes de la langue ? Je demande justement à entendre un Arabe parler esperanto à un Japonais pour être convaincue de l’intérêt oral de l’idiome. Et je constate que tous les commentaires ici font référence à de la littérature, de la poésie, des articles, des journaux sur Internet, mais rarement à des échanges oraux hors des fameux congrès tautologiques.
D’ailleurs, j’aimerais bien aussi que les spécialistes puissent me renseigner sur sa répartition géographique d’apprentissage dans le monde : y a-t-il des pays plus fervents défenseurs que d’autres ? On pourrait penser que ce sont ceux qui sont le plus soumis à l’hégémonie anglophone qui prôneraient le plus l’apprentissage de l’esperanto. Mais qui sont-ils vraiment ? Ce serait intéressant de le savoir ici. Krokodilo dit que le France a voté non à l’EO mais a-t-il des renseignements plus généraux, au-delà de l’Europe ?
Une anecdote symbolique : il y a 2 ans, tous les chercheurs du CNRS ont reçu des consignes visant à lutter contre l’anglophonie croissante et leur demandant de rédiger leurs articles en français, même dans des revues étrangères. Belle initiative mais complètement absurde quand on sait qu’un article en français a tous les risques d’être refusé d’entrée par une revue internationale (je signale que je parle anglais comme un Basque l’espagnol !). Mais jamais au grand jamais, on n’a songé à écrire ses articles scientifiques en esperanto (sauf peut-être les chercheurs en esperanto
D’abord, suite au vibrant appel de Krokodilo, je suis allée chercher sur mon iTunes les Podcasts en esperanto pour avoir une idée de la prononciation qu’évoquait Philippakos. J’en ai téléchargé deux, un émis par la Pologne, l’autre émis par l’Angleterre. Je ne peux m’empêcher de constater que la prononciation n’est pas du tout la même, et qu’elle ne tient pas seulement à un accent polonais ou autre ! Je n’y connais rien en esperanto mais pratique des langues étrangères suffisamment différentes les unes des autres pour repérer ce qui est de l’ordre d’un simple roulement de -r- ou ce qui va au-delà, avec une intonation (fondamentale dans certaines langues où si on ne marque pas les accents toniques, on s’expose à une incompréhension quasi totale), une dynamique de la phrase qui ne sera pas la même selon la nationalité de la personne, et, malgré tout, l’accent aussi, qui joue un grand rôle : quelqu’un à côté de moi vient de me dire, en écoutant la bande audio « c’est prononcé par une Chinoise », alors que c’était la « version » polonaise ! Je pose donc la question en totue naïveté : l’esperanto est-il fait pour être une langue orale ou un outil de communication écrit ? J’ai des doutes sur son efficacité internationale (et non interculturelle, qui m’a fait bondir : l’esperanto relève de tout ce qu’on veut sauf du l’interculturel ! Multi- ou poly- mais pas inter-, non !) ; bien sûr, les adeptes vont me dire « ah, au dernier congrès d’esperanto, j’ai tout compris de ce que disait mon voisin arabe » mais n’est-ce pas le lieu-même de rencontre des puristes de la langue ? Je demande justement à entendre un Arabe parler esperanto à un Japonais pour être convaincue de l’intérêt oral de l’idiome. Et je constate que tous les commentaires ici font référence à de la littérature, de la poésie, des articles, des journaux sur Internet, mais rarement à des échanges oraux hors des fameux congrès tautologiques.
D’ailleurs, j’aimerais bien aussi que les spécialistes puissent me renseigner sur sa répartition géographique d’apprentissage dans le monde : y a-t-il des pays plus fervents défenseurs que d’autres ? On pourrait penser que ce sont ceux qui sont le plus soumis à l’hégémonie anglophone qui prôneraient le plus l’apprentissage de l’esperanto. Mais qui sont-ils vraiment ? Ce serait intéressant de le savoir ici. Krokodilo dit que le France a voté non à l’EO mais a-t-il des renseignements plus généraux, au-delà de l’Europe ?
Une anecdote symbolique : il y a 2 ans, tous les chercheurs du CNRS ont reçu des consignes visant à lutter contre l’anglophonie croissante et leur demandant de rédiger leurs articles en français, même dans des revues étrangères. Belle initiative mais complètement absurde quand on sait qu’un article en français a tous les risques d’être refusé d’entrée par une revue internationale (je signale que je parle anglais comme un Basque l’espagnol !). Mais jamais au grand jamais, on n’a songé à écrire ses articles scientifiques en esperanto (sauf peut-être les chercheurs en esperanto  ). Je travaille personnellement sur certains dialectes archaïques grecs et je me verrais mal les rédiger en esperanto. Par curiosité là encore, je suis allée regarder sur Internet un dictionnaire franco-esperanto et je doute fort pouvoir parler de la dissimilation prémycénienne des labiovélaires en dorsales antérieure à la labialisation et la palatalisation !
Ce qui induit donc une autre question tout aussi naïve et curieuse : l’esperanto, langue du peuple (et donc démocrate comme le disait Krokodilo) ou langue à multi-niveaux capable d’être employée en toutes circonstances ? Les deux ne sont pas forcément antithétiques, certes, mais j’ai l’impression que le lexique mondial et national va très vite, trop vite peut-ête pour que l’esperanto suive. Il y a sans doute des mises à jour, des mots nouveaux, comme dans le Larousse chaque année, mais maintenant, qui va les créer ? Zamenhof avait conçu un système fermé, bien que vaste, et je demeure persuadée que si on a pu apprendre « sa » langue, ensemble complet et structuré, l’arbitraire de la création contemporaine de nouveaux mots peut être un frein à l’apprentissage actuel de l’esperanto.
Y a-t-il forcément un consensus autour des néologismes ? Y aurait-il un petit groupe de personnes qui se réunirait régulièrement en disant « bon, alors ce matin, on va trouver comment traduire gigabytes et logiciel » (je n’ai pas dit "software !) ? Cela me semble aller à l’opposé d’une langue qui se voudrait internationale et démocratique ! Cela opposerait donc les créateurs et le bas-peuple et à mon humble avis, qui vaut ce qu’il vaut dans sa naïveté originelle, c’est une des raisons pour laquelle l’esperanto ne se place toujours pas comme langue d’avenir.
Je ne demande pas mieux cependant que d’être convaincue et j’attends beaucoup de la force de persuasion de Krokodilo !
). Je travaille personnellement sur certains dialectes archaïques grecs et je me verrais mal les rédiger en esperanto. Par curiosité là encore, je suis allée regarder sur Internet un dictionnaire franco-esperanto et je doute fort pouvoir parler de la dissimilation prémycénienne des labiovélaires en dorsales antérieure à la labialisation et la palatalisation !
Ce qui induit donc une autre question tout aussi naïve et curieuse : l’esperanto, langue du peuple (et donc démocrate comme le disait Krokodilo) ou langue à multi-niveaux capable d’être employée en toutes circonstances ? Les deux ne sont pas forcément antithétiques, certes, mais j’ai l’impression que le lexique mondial et national va très vite, trop vite peut-ête pour que l’esperanto suive. Il y a sans doute des mises à jour, des mots nouveaux, comme dans le Larousse chaque année, mais maintenant, qui va les créer ? Zamenhof avait conçu un système fermé, bien que vaste, et je demeure persuadée que si on a pu apprendre « sa » langue, ensemble complet et structuré, l’arbitraire de la création contemporaine de nouveaux mots peut être un frein à l’apprentissage actuel de l’esperanto.
Y a-t-il forcément un consensus autour des néologismes ? Y aurait-il un petit groupe de personnes qui se réunirait régulièrement en disant « bon, alors ce matin, on va trouver comment traduire gigabytes et logiciel » (je n’ai pas dit "software !) ? Cela me semble aller à l’opposé d’une langue qui se voudrait internationale et démocratique ! Cela opposerait donc les créateurs et le bas-peuple et à mon humble avis, qui vaut ce qu’il vaut dans sa naïveté originelle, c’est une des raisons pour laquelle l’esperanto ne se place toujours pas comme langue d’avenir.
Je ne demande pas mieux cependant que d’être convaincue et j’attends beaucoup de la force de persuasion de Krokodilo ! 
-
Satire,
Je ne ferai pas un cours, j’en serais incapable. Réaction d’un néophite : Ce qui est assez « marrant » dans ce langage, c’est qu’il se contruit par des particules en plus des mots de base. Préfixes, suffixes changent la signification. Il peut donc y avoir des néologismes qui n’existent même pas dans une autre langue qu’avec l’ajoute d’un adjectif.
Si on connait la fonction de ces « particules », on construit ce qu’on veut. L’esperanto est un légo. Les règles de terminaison des mots est fixée (temps des verbes, nom, adjectif, adverbe, pluriel).
Pour le reste, krokodilo, à toi.
-
Les dicos spécialisés il est existe celui de médecine par exemple, bien sur il n’exite pas tous les dicos spécialisés en eo, le prbleme c’est qu’il n’y pas assez de monde en eo dans une spécialité pour faire un dico spécialisé. mais cela est tout à fait réalisable assez rapidement si le besoin en est au niveau de la communication, dans ma profession, il n’y avait pas de terminologie réactualisé au niveau internationale depuis un certain temps, en moins d’une année, cette terminologie était mise à jour et diffusé dans les nouveaux articles.
pour la terminologie en eo, le probleme est encore plus rapide car il suffit de prendre la terminologie commune et de l’esperantiser, ca prend 2 minutes, je l’ai tenté dans ma terminologie, il reste quelques erreures parfois mais qui peuvent facilement être gommer par d’autres moyens
Dans un autre poste une autre personne l’avais fait dans on domaine et avait aussi réussi rapidement. Donc rien n’est impossible
-
@ L’Enfoiré : merci du début de décryptage. Un peu comme en grec moderne, donc, où avec un système sémantique de préfixes, on peut créer des néologismes. Mais sont-ils pérennes ou transitoires ? Je veux bien croire néanmoins au côté ludique de la chose parce qu’à mon avis, on y retrouve des consonances familières. Cependant en turc, par exemple, langue à agglutination, l’aspect « marrant » de l’apprentissage reste peu évident pour un (Indo)Européen de l’Ouest qui n’a aucun son, aucune racine auxquels se raccrocher.
-
@Satyre,
Je réponds en vitesse. Ici, l’origine est plus proche. Je vais te donner un exemple :
Racine « nokt »
Mot nokto = la nuit (tous les objets terminés par « -o »)
pluriel noktoj = les nuits (plur « -j »)
adj nokta = nocturne (adj terminés par « -a »)
adv nokte = nuitamment (adv terminés par « -e »)
verb. inf. nokti = faire nuit (verb terminés par « -i »)
verb. pres = noktas
verb. passé= noktis
verb. furur= noktos
Prononciation : accent tonique sur avant dernière syllabe.
Suite au prochaine numero.

-
Par contre, les Turcs avancent vite en Eo
 De plus, un correspondant m’a raconté qu’il a cartonné au premier cours de turc où il s’est inscrit comme débutant, et c’est grâce à l’espéranto, aux mécanismes de vortfarado (formation de mots). Un brin d’autopub : jetez un oeil sur le manuel d’Eo traduit du russe :
De plus, un correspondant m’a raconté qu’il a cartonné au premier cours de turc où il s’est inscrit comme débutant, et c’est grâce à l’espéranto, aux mécanismes de vortfarado (formation de mots). Un brin d’autopub : jetez un oeil sur le manuel d’Eo traduit du russe :http://skirlet.free.fr/espace.htm
C’est pas long

« Mais sont-ils pérennes ou transitoires ? »
La notion de néologismes en Eo n’est pas la même que, par exemple, en français. On dit « verdoyer » mais pas « rosoyer », donc ce mot serait un néologisme. En espéranto, il est possible « verdi » (verdoyer), mais également « rozi », « flavi », « blui » etc. Un mot qui a un sens est légitime en Eo. Des vrais néologismes connaissent le même sort que dans d’autres langues : certains restent, d’autres pas. Par exemple, quand la nécessité est apparu pour le mot « ordinateur », deux mots étaient en compétition : « komputoro » et « komputilo ». C’est « komputilo » qui a gagné

-
« D’ailleurs, j’aimerais bien aussi que les spécialistes puissent me renseigner sur sa répartition géographique d’apprentissage dans le monde : y a-t-il des pays plus fervents défenseurs que d’autres ? »
Je ne saurais faire un aperçu mondial, mais en Chine il y a plus d’universités qui enseignent l’espéranto qu’en France. Certaines enseignent même en Eo. En Russie, il y a quelques universités avec l’espéranto, et j’en connais une qui enseigne en Eo. En Hongrie, l’espéranto est présent dans l’enseignement, on peut le présenter au bac.
« mais n’est-ce pas le lieu-même de rencontre des puristes de la langue ? »
Non. Les gens sont différents.
« Je demande justement à entendre un Arabe parler esperanto à un Japonais pour être convaincue de l’intérêt oral de l’idiome. »
Comme les congrès d’espéranto n’utilisent pas de traducteurs, cette situation n’a rien d’inhabituel.
« l’accent aussi, qui joue un grand rôle »
L’accent, tout le monde l’a. Il n’empêche pas de communiquer en Eo.
« Et je constate que tous les commentaires ici font référence à de la littérature, de la poésie, des articles, des journaux sur Internet, mais rarement à des échanges oraux hors des fameux congrès tautologiques. »
Essayez skype pour voir

« Une anecdote symbolique : il y a 2 ans, tous les chercheurs du CNRS ont reçu des consignes visant à lutter contre l’anglophonie croissante et leur demandant de rédiger leurs articles en français, même dans des revues étrangères »
L’anecdotique est l’utilisation d’une langue très mal adapté pour la communication internationale... Les chercheurs devraient tout de même publier en français dans les revues françaises, mais on dirait que la tendence est de se publier uniquement dans les revues anglosaxonnes, injustement considérées conne « internationales ». Mais cela confirme la nécessité d’une langue d’échanges.
« Il y a sans doute des mises à jour, des mots nouveaux, comme dans le Larousse chaque année, mais maintenant, qui va les créer ? »
Les mêmes personnes que d’habitude - les locuteurs. Ils le font depuis 120 ans déjà

« Y aurait-il un petit groupe de personnes qui se réunirait régulièrement en disant »bon, alors ce matin, on va trouver comment traduire gigabytes et logiciel« (je n’ai pas dit »software !) ?"
Non.
-
Merci à L’Enfoiré pour la première leçon. Vivement ce soir que je l’inaugure !
 Et merci aussi à Skirlet (Scarlett en EO ? Comment dit-on Rhett Butler ?
Et merci aussi à Skirlet (Scarlett en EO ? Comment dit-on Rhett Butler ?  ) pour les précisions et les réponses censées à mes questions. Allez, je me branche sur Skype EO ! Dankon multa !
Une seule chose semblerait aller dans le sens de mes idées : « komputilo » l’a « emporté » sur « komputoro », dis-tu. Usage du plus grand nombre ? Dans ce cas, c’est bien la caractéristique d’une langue. Ou décision officielle et officialisée ensuite ? Quand on voit qu’il y a encore des dissensions et des scissions à propos des accents, on peine à croire que c’est le peuple qui fait naturellement évoluer l’EO.
) pour les précisions et les réponses censées à mes questions. Allez, je me branche sur Skype EO ! Dankon multa !
Une seule chose semblerait aller dans le sens de mes idées : « komputilo » l’a « emporté » sur « komputoro », dis-tu. Usage du plus grand nombre ? Dans ce cas, c’est bien la caractéristique d’une langue. Ou décision officielle et officialisée ensuite ? Quand on voit qu’il y a encore des dissensions et des scissions à propos des accents, on peine à croire que c’est le peuple qui fait naturellement évoluer l’EO. -
Satyre satirique
Votre message est intéressant mais aborde beaucoup d’aspects différents qui chacun demandent pas mal de développements.
« Je ne peux m’empêcher de constater que la prononciation n’est pas du tout la même, et qu’elle ne tient pas seulement à un accent polonais ou autre ! »
Personnellement, j’ai pour l’instant très peu utilisé l’Eo à l’oral, mais j’ai écouté diverses radios, dont une italienne et une polonaise. On entend effectivement des différences, mais l’essentiel est homogène, à savoir l’accent tonique et le fait de ne pas diphtonguer, de bien individualiser les lettres (une lettre = un son). Au final, il y a bien moins de différences qu’entre les différents accents français, ou anglais, sans parler des différentes sortes d’anglais qui s’est beaucoup dialectisé dans le monde entier. J’ai déjà entendu un irlandais à vitesse normale, je n’y comprenais rien, pas un mot.
« Je pose donc la question en toute naïveté : l’esperanto est-il fait pour être une langue orale ou un outil de communication écrit ? » C’est une langue à part entière, donc dotée de toutes les possibilités : oral, écrit, évolutivité, avec en bonus une stabilité supérieure de par sa conception, comme le noyau dur d’une programmation (« le linux des langues » !) « l’esperanto relève de tout ce qu’on veut sauf du l’interculturel ! Multi- ou poly- mais pas inter-, non !) ; bien sûr, les adeptes vont me dire « ah, au dernier congrès d’esperanto, j’ai tout compris de ce que disait mon voisin arabe » mais n’est-ce pas le lieu-même de rencontre des puristes de la langue ? Je demande justement à entendre un Arabe parler esperanto à un Japonais pour être convaincue de l’intérêt oral de l’idiome. Et je constate que tous les commentaires ici font référence à de la littérature, de la poésie, des articles, des journaux sur Internet, mais rarement à des échanges oraux hors des fameux congrès tautologiques. »
Si après trois ans d’étude à un rythme pépère, je comprends ce qu’écrit un Japonais, ou un Anglais, qu’est-ce donc sinon un pont entre les cultures ? La conception de la langue était multi ou poly, comme vous dites, mais son usage le destine clairement à être un pont entre les cultures. Bien sûr qu’on fait souvent référence à l’écrit, la lecture chez soi est pratique pour progresser, et alors ? Si je lis des contes asiatiques, des romans d’une autre langue en espéranto, c’est bien interculturel, je ne vois pas le problème.
« On pourrait penser que ce sont ceux qui sont le plus soumis à l’hégémonie anglophone qui prôneraient le plus l’apprentissage de l’espéranto. Mais qui sont-ils vraiment ? Ce serait intéressant de le savoir ici. »
Non : ceux qui sont soumis à l’hégémonie de l’anglais, sont, comment dire, soumis ! N’oublions pas que la France dépense 80 millions d’euros par an pour diffuser des informations en anglais (France 24), le tout maquillé en plurilingue pour faire passer the pill, et que l’anglais est quasiment obligatoire (faute de choix) à l’école primaire depuis la calamiteuse réforme de l’initiation « aux » langues...
« il y a 2 ans, tous les chercheurs du CNRS ont reçu des consignes visant à lutter contre l’anglophonie croissante et leur demandant de rédiger leurs articles en français, même dans des revues étrangères. Belle initiative mais complètement absurde quand on sait qu’un article en français a tous les risques d’être refusé d’entrée par une revue internationale »
Je l’ignorais ; enfin une prise de conscience chez les scientifiques. Même l’Institut Pasteur qui a eu un beau procès à l’américaine pour la découverte du virus du sida a baissé les bras. Pas absurde du tout : en publiant en français, on garde l’antériorité en cas de litige juridique. On évite aussi que les comités de lecture des revues anglo-saxonnes gardent un article sous le coude pour raison d’évaluation et glissent quelques mots sur le sujet à une équipe concurrente... Le gouvernement pourrait très bien soutenir la prépublication systématique en français, financer la traduction, au lieu de claquer du pognon avec une télé en anglais. L’alternative, c’est la domination anglo-saxonne sur le monde scientifique, la peur de parler dans les congrès et de se montrer ridicule avec un broken english, la diffusion de leur façon de penser (ex : la brevetabilité du vivant), la mainmise par des natifs sur les postes de direction des grandes revues, des comités de lecture, des organisations internationales, de la terminologie, c’est le lent déclin du français scientifique. Si les scientifiques connaissaient vraiment quelque chose à l’Eo, ils ne pourraient que l’approuver : comment ne pas se rendre compte que les si nombreuses exceptions et tournures idiomatiques de l’anglais ou du français sont un poids immense pour la mémoire de l’apprenant, une perte de temps inouïe d’un point de vue scientifique ?
Ci-dessous, un lien vers un message où j’énumérais quelques mesures qui pourraient être prises facilement dans le domaine scientifique (« 18 mesures, etc ; ») : http://www.voxlatina.com/forums/viewtopic.php?t=1618
« Je travaille personnellement sur certains dialectes archaïques grecs et je me verrais mal les rédiger en esperanto. Par curiosité là encore, je suis allée regarder sur Internet un dictionnaire franco-esperanto et je doute fort pouvoir parler de la dissimilation prémycénienne des labiovélaires en dorsales antérieure à la labialisation et la palatalisation »
Le vocabulaire spécialisé est effectivement toujours en retard en Eo, faute d’usage spécialisé au même rythme, en temps réel, et de spécialistes de la même discipline espérantistes, mais de peu, ce n’est pas un gros problème.
« Zamenhof avait conçu un système fermé, bien que vaste, et je demeure persuadée que si on a pu apprendre « sa » langue, ensemble complet et structuré, l’arbitraire de la création contemporaine de nouveaux mots peut être un frein à l’apprentissage actuel de l’esperanto. »
Quand on crée le joli « courriel » pour remplacer « mail », c’est aussi de la création arbitraire, et alors ?
L’espéranto n’est pas un système fermé ; c’est la strucure et les règles de base qui sont fixes, constituant le noyau dur de la langue qui lui donne sa stabilité, mais les possibilités de combinaison par agglutination sont illimitées. La seule limite étant que le mot nouveau respecte les règles et qu’il ait une signification.
« Je ne demande pas mieux cependant que d’être convaincue et j’attends beaucoup de la force de persuasion de Krokodilo ! »
C’est trop d’honneur, d’autant que je ne fais que répéter ce que d’autres m’ont fait comprendre, mais si vous me permettez de répondre à un compliment par une critique (c’est mon mauvais fond qui ressort) : il vous faut aussi faire preuve de curiosité, disons plus qu’en allant voir si un dico traduit tel ou tel terme spécialisé. Sans apprendre l’Eo, mais en analysant sa structure, qui le rend à la fois souple et précis, stable et évolutif. Mes collègues ont cité beaucoup de liens vers d’intéressants articles.
-
« Et merci aussi à Skirlet (Scarlett en EO ? Comment dit-on Rhett Butler ? ) »
De rien

« Skirlet » c’est en VO, toute ressemblance avec Scarlett est purement fortuite, et les noms propres, on les espérantise ou pas, au choix.
« Une seule chose semblerait aller dans le sens de mes idées : »komputilo« l’a »emporté« sur »komputoro« , dis-tu. Usage du plus grand nombre ? Dans ce cas, c’est bien la caractéristique d’une langue. »
Exactement, c’est l’usage qui a tranché. Il n’y a pas de groupe restreint qui décide, et cela depuis la parution de Fundamento, parce que Zamenhof a abandonné tous les droits d’auteur sur la langue, en souhaitant qu’elle soit développée par les locuteurs.
« Quand on voit qu’il y a encore des dissensions et des scissions à propos des accents, on peine à croire que c’est le peuple qui fait naturellement évoluer l’EO. »
Les scissions, il n’y en a pas depuis l’affaire de l’ido. C’est juste qu’un pourcentage minime est atteint de réformite, et d’autres personnes s’essaient à la création des langues. C’es bel et bien les locuteurs qui développent l’espéranto

-
Je pense qu’une langue pour être apprise doit s’ancrer dans une motivation matérielle. Or le moteur de nos sociétés c’est le commerce, la diffusion des connaissances techniques et scientifiques et tous ça passe par l’anglais domination des USA oblige. Le besoin de communiquer passe par une langue commune et il me semble que l’anglais est bien parti pour être ce dénominateur commun. Et pourquoi pas cette langue plutôt qu’une autre.
-
Pixel (bonne idée, votre avatar, je suis jaloux, moi qui habite dans une ville orbitale)
Des raisons qui plaident contre l’anglais, il y en a des tas !
Langue très difficile (autant que le français, mais pour des raisons différentes). Je ne développe pas. En cliquant sur mon pseudo, et en cherchant mon article sur les difficultés relatives des langues, vous tomberez sur toute une discussion à ce propos.
InjusticeS : politique, scientifique, personnelle (toute situiation ou un natif doit discuter ou négocier avec un non natif). pendant les 1500 à 4000 heures que vous avez consacrées à étudier l’anglais, les anglais, eux, ont dragué des meufs, ou révisé leurs maths, ou leur anglais si difficile..., ou appris l’arabe, l’espagnol ou le chinois, gardant ainsi toujours sur nous un avantage à l’embauche ou un avantage commercial !
Illégalité : l’Union européenne a inscrit dans ses textes fondateurs l’égalité des langues !
Il a prouvé son échec dans ce rôle : depuis le temps que paraît-il le monde entier parle anglais, il faut toujours autant d’interprètes dans les réunions internationales, et les natifs prennent toujours davantage la parole que les congresistes non natifs...
-
Bonjour et merci pour l’avatar.
Pour l’anglais c’est vrai que c’est difficile. Après 7ans en scolarité je n’aligne pas deux mots. Maintenant pour l’espéranto je ne vois pas bien le moyen de l’imposer si ça passe pas par le circuit économique
-
Pixel
Les forces économiques ne sont pas les seules à régir nos sociétés, il ya aussi les assemblées, les politiques, même s’ils sont soumis aux élections et aux lobbies de l’économie... Je veux dire que si Bruxelles voulait vraiment d’une solution plus neutre, plus juste et plus efficace que l’anglais à la communication au sein de l’Europe, ils lanceraient des essais, des études, la France rendrait enfion possible en option l’étude de l’Eo. Il n’est pas nécessaire d’être immédiat, il suffit de bonne volonté, d’ouvrir le débat et de privilégier l’intérêt collectif.
-
Eh bien il faudrait l’imposer par la voie politique
 Après tout, les questions d’intérêt général et d’organisation de la société c’est dans ce rayon-là, non ? Etant donné qu’à peu près tout le monde a intérêt à ce qu’on utilise une langue commune équitable plutôt que l’anglais...
Après tout, les questions d’intérêt général et d’organisation de la société c’est dans ce rayon-là, non ? Etant donné qu’à peu près tout le monde a intérêt à ce qu’on utilise une langue commune équitable plutôt que l’anglais... -
Saluton Krokodilo,
Comme tu le sais j’ai pris un peu de temps pour apprendre les bases de l’esperanto.
Quelques leçons et quelques exercices qui ont été corrigées.
Mais, comme toujours, quand on n’utilise pas pendant un certain temps, on oublie très vite.
Vois mon premier commentaire. Je proposais de créer une rubrique « esperanto » ou « eo » (comme tu dis).
Ceux qui le désirent pouraient s’y exercer.
Remonte la proposition à Carlo (il n’est pas présent pour le moment). Pourquoi pas ?

-
Une rubrique en Eo, pourquoi pas. Ce serait bien

-
Saluton L’enfoiré, je suis pas sûr que ça corresponde bien au principe d’AV : seuls le liraient les espérantistes, et il existe déjà de nombreux forums où discuter en Eo. Que l’on puisse en parler lorsque tel ou tel aspect de l’actualité s’y rapporte, c’est déjà très intéressant, par exemple fin septembre la journée des langues, 2008 l’année des langues décrétée par l’Unesco, etc.
-
Je trouve l’article inintéressant, car pour moi le parallèle n’est pas pertinent. On n’a pas besoin d’apprendre une nouvelle langue pour aller au cinéma. Alors que l’espéranto, on a besoin de l’apprendre. Et comme il est interdit presque partout, en tout cas à l’école, c’est pas facile. Le cinéma est-il interdit depuis 100 ans ? La comparaison ne va pas loin, la raison du prétendu « échec » est vite trouvée.
Pour aller plus loin, voici quelques raisons du relatif insuccès de l’espéranto à ce jour, tirées d’une FAQ de la toile :
* 1/ Il y a mille ans, la langue la plus couramment utilisée dans les échanges internationaux était le latin. Il y a un siècle, c’était le français. Aujourd’hui, c’est incontestablement l’anglais. Oserait-on en conclure que le français est une langue du passé ? Et qu’en sera-t-il de l’anglais dans un siècle ? L’espéranto est une langue jeune, qui a encore toute la vie devant elle !
* 2/ La notion d’échec est relative à l’objectif qu’on s’est fixé. Or, d’après la Déclaration de Boulogne (09 08 1905), l’espérantisme est l’effort fait pour répandre dans le monde entier l’usage d’une langue neutre, qui « ne s’imposant pas dans la vie intérieure des peuples et n’ayant aucunement pour but de remplacer les langues existantes », donnerait aux hommes de diverses nations la possibilité de se comprendre entre eux, qui pourrait servir pour les institutions publiques dans les pays où se trouvent des rivalités de langues, et dans laquelle pourraient être publiés les ouvrages qui ont un intérêt égal pour tous les peuples. Toute autre idée que tel ou tel Espérantiste pourrait lier à l’espérantisme est une affaire purement privée dont l’Espérantisme n’a pas à répondre.
o L’objectif peut être formulé aussi : tous ceux qui la parlent peuvent se comprendre (cf [Unua Libro]). On peut dire que cet objectif est largement atteint (argument loto) : tous ceux qui l’ont appris et le parlent peuvent mettre en pratique cette intercompréhension. Chaque année, des congrès rassemblent des milliers d’espérantophones originaires de tous les continents, chaque année des romans, poèmes, chansons, pièces de théatre, etc. sont publiés en espéranto. Sur l’internet, une recherche autour du mot « espéranto » donne 46 500 000 pages environ.
* 3/ L’espéranto fait partie des 4% de langues les plus parlées au monde. Et sur internet sa place est encore plus forte. Il y a malheureusement à travers le monde des milliers de langues qui ont moins de locuteurs que l’espéranto, dont un grand nombre sont menacées d’extinction. L’espéranto se porte donc plutôt bien, et, bien que le nombre de ses locuteurs ne soit pas facile à évaluer, il semble plutot augmenter : ainsi, les cours d’espéranto, aussi bien dans les clubs locaux que lors des congrès ou sur l’internet, ne désemplissent pas.
* 4/ Le succès d’une langue ne dépend pas de ses qualités linguistiques, comme l’a bien montré Umberto Eco ; il est avant tout lié à des conditions politiques et économiques. On ne peut pas reprocher à l’espéranto de ne pas avoir été adopté par l’ONU, par l’Union Européenne etc. La responsabilité de cette non-adoption en incombe à ces organisations, et à certains pays, qui ont mis leur veto chaque fois que la question a été mise à l’ordre du jour. La position de la France est à ce titre particulièrement édifiante. Chaque fois qu’elle a pu, et qu’elle en a l’occasion encore actuellement, alors même que le français a perdu son rang de première langue internationale, relégué au rang de langue régionale par l’anglais, la France s’oppose à l’introduction de l’espéranto au baccalauréat. Et c’est la France qui a enterré le rapport Nitobe à la Société des Nations en 1922.
o C’est vrai que l’espéranto touche pour l’instant un public très inférieur au potentiel. Il réussira vraiment le jour où on le prendra enfin au sérieux, où politiciens, linguistes, et tout simplement chaque citoyen s’y intéressera sans a priori et sans mauvaise foi. Pendant des décennies, les ministres successifs ont renvoyé aux associations d’espéranto le meme discours, les memes lettres, montrant qu’ils n’avaient pas pris la peine d’étudier la question. C’est encore souvent le cas aujourd’hui, meme si une campagne auprès des partis politiques a permis à certains de prendre conscience de leur erreur.
* 5/ Since 1905 it is held an Esperanto Universal Congress every year, which people from all over the world attend. In 1993 it was held in Valencia (Spain), then in Seul in 1994, last year it was held in Tampere (Finland), in 1996 in Prague ... 2007 Yokohama. Only a few thousands out of the millions which can speak Esperanto all over the world can meet in a city -every year a different one- due to economic, professional or political reasons, but they amount to a figure significant enough to prove that assertion is false. Source : http://storm.prohosting.com/jesuo/espefaq2.htm#failure
* 6/ Et vous, vous promettez de vous y mettre quand, à travers le monde, un million de personnes auront signé cette meme promesse ? Des sondages menés dans divers endroits (en France, en Russie) on montré que 33% des personnes interrogées étaient prêtes à apprendre l’espéranto si 10 000 000 de personnes faisaient la même promesse et 33% étaient prêtes à l’apprendre si elles savaient où et comment l’apprendre. Toujours est-il que même si on se contente de 30% de gens qui seraient prêts à l’apprendre soit tout de suite, soit quand 10 000 000 de gens font cette promesse, on arrive à 20 millions des français (sur 60 millions)...
Claude Piron :
* 7/Echec./ Montrer que l’Eo fonctionne parfaitement pour ceux qui l’ont appris, et ceux-ci sont répandus sur la terre entière. Pour ceux-ci, il a parfaitement réussi. Il fonctionne très bien sur internet. Les gens qui lui reprochent de ne pas avoir réussi ne considèrent pas le rythme lent de l’Histoire. Le système métrique a été proposé en 1660. Peut-on dire que 100 après c’était un échec, car il n’était utilisé nulle part ? Non, il n’avait alors *pas encore* réussi. Mais maintenant il a pratiquement conquis le monde. L’Eo, après un siècle, se révèle un plus grand succès que le système métrique après une durée similaire.
* 8/ On peut encore dire ceci : « Est-ce que pour vous réussir signifie que le monde entier doit l’adopter ? Diriez-vous que la 2CV fut un fiasco, car de nombreuses personnes n’ont jamais acheté une 2CV ? Selon moi, si ceux qui le désiraient pouvaient l’acheter l’utiliser, et en étaient contents, elle était un succès. »
* 9/ Il n’est pas exact de dire que l’Eo a eu sa chance et n’en a pas profité. Comparé au système métrique, qui n’était utilisé nulle part 120 ans après sa publication, son succès est impressionnant. L’Eo n’a jamais cessé de se répandre, sauf pendant la période hitléro-stalinienne, mais à un rythme très lent. Il est donc trop tôt pour l’appeler un échec. Il faut attendre voir. Source : message du 05 02 2006.
10/ Il n’est pas exact que l’Eo a échoué. J’ai traversé le monde pour l’OMS, et presque partout j’ai eu des contacts avec des locaux en Eo, dont mes collègues ne parlant que l’anglais n’ont pas pu profiter. C’est vrai, l’Eo est presque inconnu en Malaisie, à Singapour, en Indonésie, en Thailande et aux Philippines, ainsi que dans les pays arabes.
Mais je l’ai abondamment parlé en Chine et au Japon, et je reçois de nombreux courriels en Eo de l’Inde, de Corée du Sud, de l’Iran, et pratiquement du monde entier. En moyenne, six mois d’Eo conduisent à un niveau de communication qui nécessite 6 ans pour l’anglais. L’Eo est donc la langue avec le meilleur rapport efficacité/coût pour les situations internationales ou interculturelles.
La raison pour laquelle l’Eo est peu connu est purement politique, mais la situation évolue. Dans un rapport commandé par le gouvernement français, l’économiste François Grin conclut de ses recherches que l’Europe économiserait 25 milliards d’euros par an si elle adoptait l’espéranto pour résoudre ses terribles problèmes linguistiques. (http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/rapport_Grin.pdf, p. 7). On constate une étrange fossé entre la réalité de l’Eo, telle que je la vis chaque jour, et l’image de cette langue dans les médias. (Message du 29 12 2005)
Comme mentionné par Krokodilo, La question n’est pas binaire (succès/échec), il faut considérer la perspective historique (le « pas encore-isme »), et comparer avec d’autres grands combats (esclavage, droits des femmes, système métrique, paix...)
Cependant comme dit aussi, le phénomène espéranto est unique et incomparable, même avec ces autres grands combats. Jamais auparavant on a essayé de populariser une nouvelle langue destinée aux échanges internationaux ... On ne peut pas se référer à une autre expérience, un autre produit ou service, un autre phénomène. C’est sans précédent.
Umberto Eco :
Le problème de l’Eo ne dépend pas de l’Eo lui-même, mais d’événements politiques, qui dépassent la volonté des espérantistes.
-
Je trouve votre message et votre réflexion intéressants. Cependant, j’aurais plutôt écrit, pour ma part : « Force est de constater que l’Espéranto n’a pas [ENCORE] connu le succès escompté. » Certaines bonnes idées mettent des siècles à percer : regardez l’idée d’une Union Européenne qui garantirait la paix ! Il a fallu beaucoup de temps, et aussi une grosse catastrophe (la deuxième guerre mondiale) pour qu’on lui donne corps...
Quand au cinéma, c’est un divertissement qui ne demande aucun effort préalable au spectateur, au contraire. L’Espéranto est un projet politique, finalement, et suppose une coordination et des efforts généralisés ; c’est plus dur que d’aller voir un film !

-
Pour Aleks et Jérémie. Non le cinéma ne coule pas de source, comme j’ai essayé de le montrer dans cet article. En projetant un film à quelqu’un qui n’en aurait jamais vu, il n’y comprendrait strictement rien. Seulement le cinéma, nous l’avons appris depuis tout petit, sans même en être conscient, comme un enfant apprend une langue étrangère alors que cela devient si difficile une fois passées les premières années de sa vie. Les expériences qui ont été faites, par le passé, de montrer des portraits photographiques à des populations qui n’avaient jamais vu de photographies (difficile aujourd’hui) ont montré que les mères ne reconnaissaient pas leurs enfants et que d’ailleurs personne ne reconnaissait personne. L’apprentissage de l’image est peut-être plus aisé que celui d’une langue (encore que les enfants peuvent apprendre plusieurs langues simultanément sans le moindre problème) mais il n’est pas inné. Pour Krokodilo Le cinéma n’est pas qu’un outil, loin s’en faut. Dire cela reviendrait à résumer un art (une expression) à sa technique... ou encore à dire qu’une langue n’est rien d’autre qu’un outil de communication (c’est je crois le problème pour l’espéranto). Après avoir lu vos commentaires, tout en étant davantage spécialiste d’images que linguiste (bien que vivant entouré de gens dont c’est le métier)je crois que le manque de succès universel de l’espéranto (on peut le regretter)tient à l’absence de culture qui va avec. Je développe : l’EO se présente comme un outil (pour reprendre l’expression de Krokodilo) et pas comme une matière vivante et évolutive comme le sont toutes les langues parlées. Ne pas oublier que ce n’est pas la grammaire qui fait la langue mais la langue qui fait la grammaire. C’est ce qui explique les exceptions dans toutes les langues, qui explique que Grévisse n’appelle pas son ouvrage de référence « grammaire française » mais « le bon usage de la langue française », conscient qu’on ne réduit pas une langue à ses règles. Zamenhof fait le contraire et invente un outil, certes extraordinaire, en édictant des règles auxquelles il essaie de faire adhérer une population. Je crois également que les gens qui apprennent une langue étrangère ne sont pas seulement intéressés par le côté technique de la communication mais qu’ils y associent un côté culturel. Un étranger qui parle le français aime souvent des auteurs français, des personnages qui parlent cette langue (acteurs, politiques, etc), bref une culture à laquelle se référer et même parfois s’identifier. Il s’ensuit inévitablement un problème d’inégalités, comme le souligne un commentaire, le natif d’une langue restant toujours supérieur à l’apprenti tardif et, dans cette mesure, Zamenhof résolvait un problème politique et social. L’expérience historique montre que la langue commune est souvent celle du dominant mais elle met du temps pourtant à se mettre en place : on parle encore grec à la cour de Rome, et le latin ne devient langue commune que bien plus tard (le peuple romain n’a jamais parlé grec pour autant). Jusqu’à présent, une langue commune apprise, que ce soit le grec, le latin ou le français, n’a jamais été une langue populaire et est toujours restée le propre de la classe sociale dominante. Puisse l’espéranto échapper à cette règle mais il reste toutefois du chemin à parcourir quant à la diffusion.
-
La grande différence entre la grammaire cinématographique et l’espérant réside à mon sens en ce que la première a évolué spontanément dans un dialogue constant entre le public et les professionnels, sélectionnant les formes commercialement et artistiquement efficaces et éliminant les formes de moindre intérêt.
A l’inverse, l’espéranto a été créé en 1887, et il était parfait, point barre. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à voir le concert de braiements que l’on obtient de la part de la communauté espérantiste dès qu’on souligne, par exemple, qu’il existe en espéranto des consonnes accentuées (eh oui). Elles sont impossible à écrire sur un clavier bien élevé, ce qui est un comble pour une langue supposée apporter une rationnalisation de la pratique linguistique. Ce point noir a d’ailleurs été soulevé dès les débuts de l’espéranto, mais les rigidités du système sont telles qu’elles n’ont conduit qu’à l’apparition de deux (deux !) graphies correctives concurrentes, en sus de la graphie d’origine.
En outre, regarder un film est souvent distrayant, lire un manuel d’espéranto beaucoup moins. L’élément motivation ’est pas le même.
-
Asp,
C’est vrai. Au sujet des caractères spéciaux, cela parrait abscon d’avoir inventé de nouveaux caractères.
Pour les installer et les utiliser avec ton clavier, il y a un petit module Ek à charger (utilisable en flip flop, désolé c’est de l’anglais)
-
Bonjour papi ASP ca va ?, tiens tu à l’air d’avoir encore alzeimer, ca vais dix fois qu’on te repete qu’avec les ordinateurs de maintenant pas ceux de ton époque que l’on peut m^^ettre des accents regarde ĉ ĥ ĵ. Chers lecteurs ne vous préocupés pas de ce que dit papi, il est comme tous les vieux li radote et n’est jamais content ; rien que son image montre qu’il est en été de décomposition avancé
-
« Je développe : l’EO se présente comme un outil (pour reprendre l’expression de Krokodilo) et pas comme une matière vivante et évolutive comme le sont toutes les langues parlées. »
L’espéranto est à la fois un outil et une langue parlée, vivante et évolutive (reconnue comme telle par des instances non-espérantistes).
« C’est ce qui explique les exceptions dans toutes les langues »
Le chinois est une langue très régulière (une seule exception grammaticale
 ), d’autres présentes des côtés réguliers (écriture, accent tonique fixe etc.) L’espéranto n’a rien d’inhumain de ce côté-là. De plus, les exceptions n’apportent strictement rien à la communication, ils ne font que la ralentir. D’ailleurs, les langues « naturelles » ont aussi une tendance de se débarraser des complications inutiles : certains temps verbaux ne sont plus utilisés en français, et tous les verbes nouvellement crées sont du premier groupe (sauf « alunir » qui est du deuxième, mais aucun n’appartient au troisième).
), d’autres présentes des côtés réguliers (écriture, accent tonique fixe etc.) L’espéranto n’a rien d’inhumain de ce côté-là. De plus, les exceptions n’apportent strictement rien à la communication, ils ne font que la ralentir. D’ailleurs, les langues « naturelles » ont aussi une tendance de se débarraser des complications inutiles : certains temps verbaux ne sont plus utilisés en français, et tous les verbes nouvellement crées sont du premier groupe (sauf « alunir » qui est du deuxième, mais aucun n’appartient au troisième).« Jusqu’à présent, une langue commune apprise, que ce soit le grec, le latin ou le français, n’a jamais été une langue populaire et est toujours restée le propre de la classe sociale dominante. »
L’espéranto est très démocratique, accessible à toutes les classes sociales.
-
L’auteur,
« je crois que le manque de succès universel de l’espéranto (on peut le regretter)tient à l’absence de culture qui va avec. Je développe : l’EO se présente comme un outil (pour reprendre l’expression de Krokodilo) et pas comme une matière vivante et évolutive comme le sont toutes les langues parlées. »
L’idée qu’une langue n’est pas un simple outil mais le véhicule d’une culture a longtemps été le premier argument des milieux enseignants contre l’idée même de l’Eo. Pourtant, une chose est frappante : depuis quelques années, les pédagogues eux-mêmes parlent d’anglais international, d’anglais de communication (ou plus vulgairement basic english, anglais d’aéroport !. Qu’en conclure ? Que la notion de langue auxiliaire, langue pont entre les cultures fait petit à petit son chemin, car le dogmatisme ne peut résister éternellement à la réalité. Autre exemple, l’Union européenne, qui s’est fondée sur l’égalité des langues, a dû s’adapter aux nécessités, et mettre en place trois langues de travail ; en outre, il ne faudrait pas pousser beaucoup la Commission européenne pour leur faire dire que la lingua franca de l’Europe doit être l’anglais...
Evidemment qu’un étranger qui apprend le français est intéressé par notre culture, ou le sera un jour, mais soyons honnête : la plupart de nos maigres connaissances sur les autres cultures nous viennent de la traduction. Quelques personnes lisent en VO dans une langue étrangère, quelques-unes dans deux, au-delà on tombe dans l’exceptionnel. Ou des contacts directs en voyage, mais là aussi par la traduction, ou en se limitant au visuel.
Et l’un n’exclut pas l’autre : une langue peut être choisie comme langue-outil de communication et posséder une culture. De plus, la naissance puis le développement de l’espéranto, même minoritaire et marginal (mais réellement international), est par lui-même un phénomène culturel sans précédent. Un phénomène culturel n’est-il pas de la culture ?
-
Bien vu pour l’anglais qui en se simplifiant pour les étrangers s’éloigne de la culture anglaise pour devenir acculturé dans sa version internationale. Preuve aussi, s’il en était besoin, de la forte demande d’une langue universelle, demande qui ne peut que s’accroître avec la mondialisation. Alors, partisans de l’espéranto, vous savez ce qui vous reste à faire...
-
Asp Explorer,
Lorsque vous déclarez : « regarder un film est souvent distrayant, lire un manuel d’espéranto beaucoup moins. L’élément motivation ’est pas le même. », vous entrez dans le débat, jusque là modéré, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine !

Il conviendrait de comparer ce qui est comparable : entre le manuel d’utilisation d’une caméra et un (bon) cours d’espéranto, la comparaison est plus équitable. De toutes façons, il ne s’agit que d’étapes obligatoires pour la satisfaction future de bien utiliser le matériel et d’en exploiter toutes les possibilités créatives.
Maintenant, si j’ai le choix entre un navet américain à l’eau de rose ou un bouquin de Raymond Shwartz (qui est sûrement pour vous un parfait inconnu), je n’hésiterais pas une seconde.
Le chaînon manquant, pour moi, il est là : un bon cinéaste espérantophone (avec des moyens financiers pas trop ridicules) pour porter à l’écran « Kredu min, sinjorino ! » de Cezaro Rossetti, ou « Kiel akvo de l’rivero » de Shwartz. Ce serait un vrai régal !

-
Il me répugne vraiment en ajoutant ici mon commentaire de faire remonter le score poussif de ce fil né sous une mauvaise étoile, mais puisque la haine m’y conduit sans pour autant m’aveugler, je consens à jeter quelques ducats dans cette poussière mêlée de crachats.
Bien que les commentateurs ne l’aient pas fêté, on accordera quand même à l’auteur, qui prétend vivre à Athènes, mais ignore en réalité presque tout de la culture millénaire du berceau de la culture européenne, qu’il a choisi son sujet on ne peut plus à souhait.
Parler de l’espéranto lui sied comme un gant (excusez-moi d’utiliser une image aussi éculée, mais je n’ai nulle envie de me fatiguer le cerveau pour un papier si médiocre).
Je vois en effet maints parallèles inattendus entre cette langue bricolée et notre misérable écrivant : origines mélangées confinant à la bâtardise ; simplicité, simplisme même, ignorant les exceptions et les nuances et donc synonyme de plate et ennuyeuse uniformité de la pensée ; absence de culture et d’histoire, plante d’un jour, banal champignon phallique artificiel d’une nuit, sans racines ni beauté.
Je n’en dirai pas plus—un rire olympien commence à faire trembler dangereusement ma plume !—si ce n’est que le latin, langue de l’éternelle Rome des Césars et des papes, est la seule langue qui par sa pureté, sa magnifique et stimulante complexité, sa culture surabondante et séculaire, soit digne de devenir la lingua franca du continent européen, si pas de tous les peuples de la terre dans leur mutuel commerce.
Je terminerai en exhortant notre sot larbin, dans l’intérêt d’une crédibilité déjà sérieusement ébrechée par des divagations intempestives sur les vierges (créatures qui lui sont de toute évidence étrangères), à s’appliquer à lui même les règles d’orthographe auxquelles il prétend pompeusement me lier, et donc d’écrire scrupuleusement avec un « k » tous les mots français dérivés de mots grecs contenant à l’origine un kappa.
Kakophonie et non cacophonie. Katastrophe et non catastrophe. Kymbale qui résonne et non cymbale qui raisonne.
Je vous salue bien bas, monsieur le pidginiste ignorant. Mes respects à votre bonniche créole, qui vous souffle de si pertinentes réponses dans vos difficultés lexicales.
-
Boileau, la haine est un sentiment destructeur. Fustiger une langue dont vous ne connaissez rien est ridicule, mais je vous laisse à votre ignorance dont vous êtes tellement fière.
« le latin, langue de l’éternelle Rome des Césars et des papes, est la seule langue qui par sa pureté, sa magnifique et stimulante complexité, sa culture surabondante et séculaire, soit digne de devenir la lingua franca du continent européen, si pas de tous les peuples de la terre dans leur mutuel commerce. »
Le latin est une langue morte selon les définitions officielles. Sa culture séculaire ferait bien rire les autres cultures plus anciennes. quant à la culture « surabondante », il y a des siècles que rien n’a été produit en latin, et les autres cultures se sont beaucoup étoffées.
Sans parler d’un point purement pratique : le vocabulaire du latin est largement insuffisant et inadapté aux réalités d’aujourd’hui. Il faudra le moderniser, autrement dit « bricoler » - c’est ce que vous reprochez à l’espéranto.
-
Boileau419
« n’ai nulle envie de me fatiguer le cerveau pour un papier si médiocre »
On attend avec impatience les brillants articles que votre cerveau, héritier d’une culture millénaire, ne manquera pas de produire, mais sur un sujet plus digne de votre intérêt que l’espéranto, cela va sans dire.
« Je vois en effet maints parallèles inattendus entre cette langue bricolée et notre misérable écrivant : origines mélangées confinant à la bâtardise »
Aurait-il échappé à votre universelle sagesse que toutes les langues ont des origines mélangées ? Auriez-vous quelque fantasme inconscient de race linguistique pure ?
« ce n’est que le latin, langue de l’éternelle Rome des Césars et des papes, est la seule langue qui par sa pureté, sa magnifique et stimulante complexité, sa culture surabondante et séculaire, soit digne de devenir la lingua franca du continent européen, si pas de tous les peuples de la terre dans leur mutuel commerce. »
Allez dire ça aux chinois, une des plus anciennes civilisations de la Terre, qui nous ont longtemps considérés comme des barbares (et peut-être encore aujourd’hui), latinistes inclus, et rapportez-nous leur réponse !
-
Qu’en termes délicats, ces choses là sont dites, Boileau !
Puisque seul le latin vous passionne, je vous propose ce petit thème. Comment diriez-vous, en cette langue antique :
« Depuis qu’elle s’est mise à la coke, plus rien ne l’arrète ! J’ai même l’impression qu’elle se la pète. »
En espéranto, ça donnerait par exemple :
« De kiam shi ek-snufis kokainon, nenio shin bremsi kapablas ! Ech aroganta, shi al mi shajnas. »
Mi esperas ke vi ne estas shokita.

-
« Enfin, essaie de prévenir des dangers de la manipulation graphique dont les règles sont souvent bien connues de ceux qui l’utilise mais pas forcément des spectateurs qui en sont victimes. »
Entre deux passages au Kerameikon, tâchez de corriger les fautes d’orthographe et de grammaire de votre profil, Mardonios.
Je ris.
-
« Enfin, essaie de prévenir des dangers de la manipulation graphique, dont les règles sont souvent bien connues de ceux qui LES utiliseNT mais pas forcément des spectateurs qui en sont victimes. »
J’ai eu peur que vous ne rajoutiez des fautes en tentant maladroitment de vous corriger. Maintenant c’est parfait, sauf que le ton de votre profil est d’une vanité effarante (sans doute à cause de l’emploi de la troisième personne).
Faites attention à vos virgules. Il en faut une avant « dont » puisqu’il s’agit d’une relative explétive ou explicative, si vous préférez (madame la grammairienne me corrigera si je me trompe).
Pour « les » j’hésite un peu. Peut-être que le pronom renvoyait à « manipulation », mais de toutes façons la phrase est bancale et trop compliquée.
Enfin, je m’efforce de mettre en garde contre la manipulation des images, dont les règles, bien connues du spécialiste, ne le sont pas toujours de leur victime, le spectateur.
-
Un des moyens aussi pour qu’un film puisse se diffuser, c’est la langue, quel américain moyen connait un film allmend ou polonais par exemple.A part certains filmes ou l’image est le moyens principal pousé à l’extreme (chaplin en partie), les fameux films muets, quel film ou série télé (lost friends, ect par exemple) peu être compris sans le son, très peu en résumer. l’image apporte une émotion différente de celle de la parole ou de l’écrit littéraire (balzac par exemple), voire même un plus en ajout de la parole. un exemple concret les lecteurs de balzac vivent différement l’histoire dans le livre par rapport au film dans germinal, chacun apporte sa chose son élément, mais coupez le son et le filme devient terne et difficille à comprendre, sauf si on lit sur les lèvres et la encore c’et une forme de language (qui plus est n’est pas traduisible car les levres ne montrent uniquement car inscrit dans l’immage et non dans le son).
Un autre exemple certaines chanson sans un clip ne valent pas clou d’autres avec un clip sont moins, bien, bon bien sur la dessus on tout à l’émotion donc au subjectif remarque le cinéma est aussi subjectif.
On peut aussi remarquer quelque chose dans l’histoire du cinéma, rendre réel ce qui n’est pas réalisable. au début se fut le son, avec au début avec l’image de l’écriture entre deux scènes (un moyen bien limité) puis est venu la bande son qui s’est amélioré par sot pour arriver à la HD, comme autre évolution aussi les éffets spéciaux entre les dinosaures de mes parents et ceux de jurasique park, il y a une nette différence.
Pourquoi cette évolution ? donner plus pour épater plus ? mais aussi entretenir la flamme du cinéma ? m^me à aller au cinéma poubele, un film un jour au autre le lendemain, en oubliant déjà celui vu la veille ? Comment se serait passé le film sans le son, sans les effets spéciaux ?.
le film de manière globale est devenu une usine à fric avec les produits dérivées les magazines, une machine de guerre, de propagande parfois, d’isolement par certains régimes (par la langue dans la traduction en partie, véhicule principale de la pensé).
L’eo son évolution , au départ vouloir être parler par des personnes quel que soit le nombre peut importe, avec un idéal, devenir langue pont pour la communication sans forcer les gens. Un moyen de propagande internationale sans transformation de l’information volontairement au moyen de la traduction en tre langues nationales
en comparent le ciné et l’eo, l’un de rien est parti sur pas mal de choses qu’il ne maitrise pas toujours, l’autre reste toujours dans son obtique dont le final peut e^tre maitrisé
-
A l’auteur je conseillerais d’aller voir le site de Claude Piron http://claudepiron.free.fr/articles.htm traitant de l’espéranto un site bien fourni et surtout d’y regarder avant de poser des questions dans le forum ou certains afirmations (comme par exemple absence de culture si j’ai bien compris), ou le livre le défis des langues ou le que sais-je au sujet de l’eo.
Coordialement
-
Tout d’abord je tiens à remercier tous les participants à cette discussion pour la diversité et la pertinence de leurs commentaires. Ensuite, en y repensant, peut-être l’espéranto réussirait-il à prendre son envol s’il était intégré comme première langue pour une nouvelle génération qui se chargerait vite de le rendre vivant et évolutif. Les plus fervents partisans de l’espéranto pourraient tenter cette expérience avec leurs enfants par exemple. On passerait alors d’une langue apprise en système figé à une langue maternelle, naturelle, à la naissance d’une culture. Cette proposition semble assez incongrue (voire utopique), je le reconnais volontiers. Compte tenu du nombre de locuteurs dans le monde, le risque d’isolement ne serait-il pas démesuré ?
-
l’eo est bien vivant et evolutif, pourquoi en langue maternelle bien que cela existe déja en tant que langue maternelle. les espérantophones veulent uniquement que les personnes puissent se comprendre entre eux sans qu’elle devienne langue maternelle, rien que le fait de pouvoir l’introduire en option au bac serait une grande avancé. beaucoup de chose sont tentés et ont été tentés par les espérantistes pour son dévelopement, mais un certains nombre de faits différents, volontaires ou involontaires convergents font qu’elle ne peut pas prendre son éssort final, celle de sa diffusion complete au niveau mondiale.
Son seul point faible c’est le nombre de locuteur pour devenir de manière relle une langue pont bien meilleure que l’anglais , pour le reste elle a une histoire, une culture, une richesse, une personalité propre, le tout dans la simplicité (qui ne veux pas dire incomplete au niveau du language, voir le site de claude piron http://claudepiron.free.fr/articlesenfrancais/simple.htm http://claudepiron.free.fr/articlesenfrancais/ecrivain.htm http://claudepiron.free.fr/articlesenfrancais/culture.htm ect............................ kore
-
A mon avis, même des locuteurs très très familiarisés avec l’esperanto ne peuvent prétendre le parler quotidiennement à la maison au point qu’un enfant le considère comme une langue acquise naturellement et non apprise, ce qui est la caractéristique d’une langue maternelle. C’est un peu le problème de la poule et de l’œuf. Philippakos, toi qui parles grec moderne parce que tu es venu vivre dans le pays, te verrais-tu ne parler que cette langue à ton fils au point qu’il en apprenne toutes les subtilités grâce à toi ? Ce n’est pas ta langue maternelle et donc tu as déjà un « moins » par rapport au français dans cette langue. « Moins » qui sera répercuté chez ton fils s’il ne l’apprend que de toi. Et effectivement, je parle du grec qui est la langue d’un pays. Que faire avec l’esperanto qu’un enfant risque de n’entendre régulièrement qu’à la maison ? La gageure me semble utopique mais c’est peut-être un moyen d’amorcer une vaste diffusion de l’EO. Est-ce que Esperantulo peut me dire où l’EO « existe déjà en tant que langue maternelle » ???? La définition de langue maternelle est à revoir à mon avis, mais ceci est un autre débat (tout comme le drapeau de l’EO ! Le drapeau reflète un peuple, une ethnie, une nation, un pays, mais pour une langue artificielle, l’idée me semble saugrenue).
-
Un enfant chinois née en France, quelle est sa langue maternelle ? Et en quoi est-il étonnant, quand les parents de langue maternelle différente échangent en famille en espéranto ? Enfin, vous pouvez leur poser la question directement :
http://www.helsinki.fi/ jslindst/denask-l.html
En tout cas, voici des données officielles sur les natifs Eo :
http://www.ethnologue.com/14/show_language.asp?code=ESP
« Le drapeau reflète un peuple, une ethnie, une nation, un pays, mais pour une langue artificielle, l’idée me semble saugrenue). »
Alors le drapeau, disons, olympique est saugrenu.
Un drapeau peut également réfleter une idée, un mouvement, une diaspora, etc.
-
« Les plus fervents partisans de l’espéranto pourraient tenter cette expérience avec leurs enfants par exemple. »
Ce ne sont pas les plus fervents qui s’y essaient, ce sont simplement des couples mixtes qui se sont connus grâce à l’espéranto. Sinon l’espéranto n’est pas censé devenir la langue maternelle universelle, mais un moyen auxiliaire de communication. D’ailleurs, les enfants l’apprennent facilement (en tant que langue étrangère) et s’amusent bien

-
De satyre :
« A mon avis, même des locuteurs très très familiarisés avec l’esperanto ne peuvent prétendre le parler quotidiennement à la maison au point qu’un enfant le considère comme une langue acquise naturellement et non apprise, ce qui est la caractéristique d’une langue maternelle. »
Un enfant n’aquiere jamais naturellement une langue, sinon les dislexies n’existeraient. un enfant comme un adulte apprend tous les jours sa langue. de plus selaon la definition du dictionnaire hachette :« une langue maternelle est celle du milieu où l’on a été élevé ». Donc la langue des parents et celle de son entourage affectif et audiovisuel. donc par exemple si les deux parents parlent francais en france, l’enfant aurat le franacis comme langue. si les parents parlent que arabe en france, soit l’enfant parle que arabe s’il n’a pas de contacte avec des francais ou alors le francais et l’arabe avec possibilité de prédominace d’une langue sur l’autre suivant les circonstances. un parent parle francais, l’autre anglais, l’enfant peut alors parler les deux langues, si ils vivent en angleterre, l’enfant aurat plus tendance à avoir l’anglais comme langue dominante par rapport à son autre langue maternelle le francais et inversement si ils vivent en france.
Maintenant le cas de l’esperanto, s’il est utilisé par la famille il entre dans le domaine de la langue maternelle. l’enfant pourrat selon des degrés divers suivant son utilisation l’utiliser dans le cercle familiale. donc soit être langue maternelle dominé soit être langue égale à l’autre langue ou les autres langues.
dans le monde il existe des familles à trois langues.
cas 1 : pere francais, mere allemande, pays de vie angleterre, l’enfant pourrat avoir trois langues maternelles, aves des degrés de dominance divers suivant les cas :
cas 2 : pre francais, mere allemande, pays de vie france, langue de famille espéranto, l’enfant aura les mêmes moyens que dans le cas 1
cas 3 : pere anglais, mere allemend pays france, langue de famil espéranto, la on atteint le stade de quatre langue avec des degrés divers de dominace chez l’enfant
« C’est un peu le problème de la poule et de l’œuf. Philippakos, toi qui parles grec moderne parce que tu es venu vivre dans le pays, te verrais-tu ne parler que cette langue à ton fils au point qu’il en apprenne toutes les subtilités grâce à toi ? »
langue maternelle ne veut pas dire grande haute matrise de la langue et de toutes les subtilités,par exemple en milieu carceral certains jeunes ont à peine 1000 mots de leur langue maternelle, comparé à des enfant de personnes très lettré ou ecrivain qui penvent avoir un vocabulaire impressionant. et il est même rare de trouver des personnes maitrisant toutes les subtilités d’une langue, Gui Bedod en fesait partie par exemple
« Ce n’est pas ta langue maternelle et donc tu as déjà un »moins« par rapport au français dans cette langue. »Moins« qui sera répercuté chez ton fils s’il ne l’apprend que de toi. Et effectivement, je parle du grec qui est la langue d’un pays. »
comme dit précedement, plus le milieu familial est élévé, plus la maitrise de la langue serat élévé et plus il baisse et plus cette maitrise serat faible, l’école aussi peut faire baisser cette maitrise (recement c’était l’orthographe en 6eme).
Donc on maitrise une langue maternelle selon des degrés divers et selon surtout l’utilité du vocabulaire. En afrique certaines langues en voit d’extinction dans des peuples agricoles ancestraux n’ont pas de vocabulaire très technique ou poussé sur un certain nombre de choses (par exemple le mot pour « phoque » n’existe pas dans certaines langues car inexistant dans le milieu culturel). certaines langues ont mêmes isparus par manque de vocabulaire car l’histoire du peuple était trop gregaire. Un papou aurat’il la m^me étendu de vocabulaire qu’un francais, non car se sont deux milieux différents, chez le papou un vocabulaire réduit est suffisant alors que chez un francais c’est insuffisant
« Que faire avec l’esperanto qu’un enfant risque de n’entendre régulièrement qu’à la maison ? »
Rien de particulier le laisser vivre
« La gageure me semble utopique mais c’est peut-être un moyen d’amorcer une vaste diffusion de l’EO. Est-ce que Esperantulo peut me dire où l’EO »existe déjà en tant que langue maternelle« ? ? ? ? »
Quelquun a déja répondu
« La définition de langue maternelle est à revoir à mon avis, mais ceci est un autre débat (tout comme le drapeau de l’EO ! Le drapeau reflète un peuple, une ethnie, une nation, un pays, mais pour une langue artificielle, l’idée me semble saugrenue). »
Tout chose peut être revue, les drapeaux sa va, sa vient peut être qu’un jour, il changerat peut être un jour c’est aux locuteurs d’en décider, moi ma preférence va au drapeau arc en ciel, c’est celui qui irait le mieux pour l’eo, mais il est déjà pris
-
L’auteur,
« On passerait alors d’une langue apprise en système figé à une langue maternelle, naturelle, à la naissance d’une culture. »
En fait, il y a déjà une culture, simplement, celle-ci est méconnue, de même qu’il existe dans le monde des tas de cultures dont nous ne savons rien. Et si nous savons quelque chose sur la Corée, ou la culture péruvienne, alors ce seront les légendes inuits ou javanaises que nous ignorerons. Il faut garder à l’esprit que nous savons finalement très peu de choses les uns sur les autres.
-
Oui, il est vrai que des romans ont été écrits, des films tournés. Est-ce suffisant pour faire une culture ? Il semblerait qu’une culture soit définie par une communauté de traditions qui implique donc un « vivre ensemble ». Mais peut-être faut-il laisser le temps faire son travail. Pour une culture, un siècle c’est très peu.
-
Alors il faut définir ce que c’est une culture. Les peuples qui ne possèdent pas de langue écrite ont-ils une culture ? Les livres, les films, les chansons etc. - pourquoi ce ne serait pas une culture ? Il faut des traditions - eh bien, il y en a quelques-unes en espéranto. Combien de temps faut-il les faire vieillir et qui a déterminé ce temps ?
-
Une culture : ne presente pas forcement des livres ou des ecrits, dans les langues orales (sans aucun écrit), la culture se présente par les traditions et surtout une idéologie commune pour contruire un groupe un peuple qu’il soit sur un teritoire défini ou en diaspora, qu’il soit écrit ou que oral, qu’il soit jeune qu’il soit vieux. L’espéranto a une culture hyper active car l’espéranto c’est le mélange, le contact de cultures différentes de peuples différents. Les écrits ou l’orald’un pays ou d’un peuple montre une culture même si elle n’est pas toujours perceptible, cla peut e^tre un sens négatif à un mots, une modification de sens, un changement de style, cela fait partie de la culture qu’elle soit jeune ou vieille.
l’espéranto n’échappe pas à cette rêgle, elle a une idéologie qui se modifie avec le temps entre 1900 et les années 2000, les idées vhéiculé par ses locuteurs, pour la langue et par la langue s’est modifié, on peut le remarquer aussi dans son écrit, changement de style chez les écrivains (l’ epoque zamenof, puis haunld, puis waringher, puis piron) d’écrit, augmentation du vocabulaire, puis réduction, création d’arkaismes, d’augmentation de sens pour un mots (krocodili par exemple)
Certaines cultures sont très « completes » ou complexes, d’autres simples, mais elles vont toutes dans le sens du mouvement, de la création et de l’absortion
-
à Phillippakos, qui a écrit :
« ...peut-être l’espéranto réussirait-il à prendre son envol s’il était intégré comme première langue pour une nouvelle génération qui se chargerait vite de le rendre vivant et évolutif. Les plus fervents partisans de l’espéranto pourraient tenter cette expérience avec leurs enfants par exemple. On passerait alors d’une langue apprise en système figé à une langue maternelle, naturelle, à la naissance d’une culture. Cette proposition semble assez incongrue (voire utopique), je le reconnais volontiers. Compte tenu du nombre de locuteurs dans le monde,... »
Ni incongrue, ni utopique, puisqu’il existe déjà plusieurs centaines de familles utilisant l’espéranto au quotidien. Les enfants y sont souvent trilingues de naissance : langue de la mère, langue du père et espéranto. Il existe aussi une revues, des listes de discussion et même des rencontres internationales organisées par et pour tout ce petit monde.
Je connais personnellement quelques unes de ces familles, et il est réconfortant de constater que ce sont des gens « normaux », avec ni plus ni moins de problèmes que d’autres.
-
Alors expliquez-moi pourquoi, compte tenu de tout ce que j’ai appris, il n’y a pas plus de deux millions de personnes maitrisant l’espéranto dans le monde. Et encore je voudrais savoir si on peut parler de bilinguisme pour les deux millions. Certains intervenants de ce forum ont avoué n’avoir que quelques dizaines d’heures d’espéranto derrière eux. Dans ces colloques espérantistes, comment analysez-vous la situation ?
-
C’est simple : combien de personnes étudie une langue étrangère pendant son temps libre, sans y être obligé par le travail ou le lieu d’habitation ? La majorité absolument écrasante étudie une ou deux langues étrangères pendant la scolarité, et rares sont ceux qui le continuent par plaisir. Si l’espéranto était aussi présent et accessible dans les établissements scolaires que l’anglais, il compterait bien plus de locuteurs que les deux millions mentionnés.
« Certains intervenants de ce forum ont avoué n’avoir que quelques dizaines d’heures d’espéranto derrière eux. »
Une heure d’espéranto équivaut à plusieurs mois d’une langue moins régulière. Les 16 règles de grammaire se tiennent sur une feuille - comparez-les avec la taille de Grevisse

De l’autre côté, quand on nous assène des sondages bidons (ceux d’Eurobaromètre, pa exemple), en présentant les chiffres des personnes « qui parlent anglais », il ne s’agit évidemment pas du bilinguisme. Certains prétendent parler anglais après l’avoir étudié au primaire (ce détail croustillant est également sur la page d’Eurobaromètre).
-
Débat intéressant. L’esperanto permet de lexicaliser la grammaire. Ainsi le sexe féminin est exprimé par le suffixe -IN, présent dans les grandes langues européennes (queen, konigin, tsarine regina, reine etc), ce qui permet de combiner sur ce point la simplicité de l’anglais et la clarté des langues latines. Le préfixe MAL- exprime le contraire et permet de diminuer pratiquement par deux la liste des adjectifs...
La connaissance d’une quarantaine d’affixes ainsi que de 17 désinences ou terminaisons, 5 non verbales, 12 verbales, permet de combiner à une simplification incroyable du vocabulaire et à une régularité absolue de la grammaire qui s’écrit sur une carte postale, une grande clarté.
Seule langue internationale construite qui fonctionne depuis 120 ans avec plusieurs millions de locuteurs l’esperanto a fait ses preuves. La plupart de ceux qui l’ont appris l’ont fait en autodidactes car il s’apprend comme un jeu de construction.
Question : Combien de films auraient été produits dans le monde s’ils ne disposaient que du budget de l’esperanto (Eo) ?
Le blocage principal pour l’Eo reste idéologique par méconnaissance et politique par opposition de l’impérialisme linguistique dominant. Mais avec la révolution informatique et la mondialisation, 94% dela population mondiale non anglophone pourraient accéder à un bon niveau de langue internationale en quelques dizaines d’heures , respectivement dix fois et cinquante fois moins de temps en Europe et en Chine que pour l’anglais, langue bourrée d’exceptions.
Vive le cinéma et vive l’esperanto deux inventions qui vont devenir essentielles au XXIème siècle.
-
« 94% de la population mondiale non anglophone pourraient accéder à un bon niveau de langue internationale en quelques dizaines d’heures »
Mais ne pourrait ni lire Shakespeare, ni Goethe, ni Dante, ni Hugo, ni..., ni...

Permettez-moi d’être candide : quel est l’intérêt d’apprendre une langue si elle ne permet pas d’accéder - aussi modestement que ce soit - à une meilleure connaissance de la culture de l’autre ou de notre histoire ?
-
« Mais ne pourrait ni lire Shakespeare, ni Goethe, ni Dante, ni Hugo, ni..., ni... Permettez-moi d’être candide : quel est l’intérêt d’apprendre une langue si elle ne permet pas d’accéder - aussi modestement que ce soit - à une meilleure connaissance de la culture de l’autre ou de notre histoire ? »
Sans faire l’apologie de l’esperanto (il est encore un peu tôt, même si Krokodilo peut se rassurer sur ma curiosité d’esprit !), les exemples choisis sont peu pertinents : Shakespeare, soit, pour l’anglais, mais pourquoi n’y aurait-il pas de traductions en esperanto d’Hugo tout autant qu’en anglais ? Le tout est de systématiser les traductions si on en a les moyens, et n’importe qui pourrait avoir accès à tout, aussi bien avec la Divine Comedy qu’avec la Dia Comedia (euh, je n’ai pas trouvé comédie dans mon dictionnaire en ligne d’EO....
 ) !
) ! -
MrSel,
Vous croyez vraiment qu’on apprend l’anglais pour lire Shakespeare en VO, ou étudier l’histoire de l’Angleterre en anglais ?
-
« Mais ne pourrait ni lire Shakespeare, ni Goethe, ni Dante, ni Hugo, ni..., ni... »
Personnes capables de lire à la fois Shakespeare, Goethe, Dante et Hugo sont rares. Le plus souvent, on lit les traductions. Et de ce point de vue, l’espéranto n’a pas à rougir
 Il existe les traductions des écrivains susnommés. Qui plus est, l’espéranto possède également la littérature originale, ne soyez pas pressé de la dénigrer avant d’en avoir lu
Il existe les traductions des écrivains susnommés. Qui plus est, l’espéranto possède également la littérature originale, ne soyez pas pressé de la dénigrer avant d’en avoir lu 
Ensuite, vu le peu de temps que prend l’espéranto pour doter les gens d’un moyen de communication performant, rien n’empêche d’étudier une langue de son choix (par forcément l’anglais « utile »). D’ailleurs, parmi les espérantistes le pourcentage de polyglottes est élevé (c’est sans compter l’espéranto dans la liste).
Et « notre histoire », on l’apprend dans notre langue maternelle, n’est-ce pas ?

« euh, je n’ai pas trouvé comédie dans mon dictionnaire en ligne d’EO »
« Komedio ». Et le titre de l’oeuvre de Dante est « La Dia komedio »

-
à MrSel : il existent bien des oeuvres classiques traduites en espéranto. Mais également, beaucoup d’autres traduites de l’espéranto dans différentes langues...

.
-
« Je suis convaincu que la généralisation de l’emploi de l’espéranto pourrait avoir les plus heureuses conséquences en ce qui touche les relations internationales et l’établissement de la paix universelle. Mais il conviendrait d’inscrire l’obligation de son enseignement dans les programmes scolaires, semble-t-il. L’effort qui serait demandé aux jeunes gens après l’instruction primaire qui doit, à mon avis, se limiter à l’étude de la langue maternelle, serait peu de chose et préparerait ainsi très facilement la jeunesse à l’échange international des idées et des transactions de toutes sortes. Ce n’est que par l’obligation qu’une telle instruction pourrait être effective et efficace. »
Cet avis a été formulé précisément par Louis Lumière (1864-1948), qui fut l’un des 42 savants signataires d’un voeu de l’Académie des sciences, Institut de France : http://www.esperanto-sat.info/article207.html
-
« Vous croyez vraiment qu’on apprend l’anglais pour lire Shakespeare en VO, ou étudier l’histoire de l’Angleterre en anglais ? »
Je réagis à cette réponse qui recouvre assez bien la plupart des réactions qu’ont suscitées mon commentaire : OUI !
Oui, pouvoir lire Shakespeare en VO est une puissante motivation pour apprendre l’anglais.
Oui, lire Shakespeare en VO est une expérience beaucoup plus gratifiante que de le lire en langue française, espérantiste ou même en latin.
Ceux d’entre vous qui me répondent que « des traductions des classiques existent » ont-ils déjà pris la peine de lire le même livre dans sa langue originelle et dans sa traduction ? Oseraient-ils affirmer que les traductions disponibles peuvent rendre justice au style employé par l’auteur ? Qu’elles permettent de comprendre la place d’une oeuvre dans sa culture d’origine ?
Si vous ne disposez que de quelques heures et que vous n’avez jamais fait l’expérience de lire un livre dans deux langues différentes, faites-le, cet exercice est particulièrement riche d’enseignements !
-
Entièrement d’accord, sauf que cela implique un niveau de bilinguisme élevé que peu d’entre nous possède. Sinon, on bute sur les phrases, on accumule les contresens et on perd la sensibilité du texte. Encore plus édifiant voir un film en VO et doublé. On réalise que pour suivre vaguement les mouvements des lèvres, les traducteurs en viennent parfois à modifier radicalement les phrases. Les sous-titres ne sont pas non plus la panacée. Voir un film étranger dont on connaît la langue en VO et lire les sous-titres en français, ou un film français et lire les sous-titres dans une langue qu’on connaît bien. Un exemple : « Il faut passer la région au peigne fin », devient avec un mauvais sous-titre : « il faut visiter la région »peignefin« ». Le traducteur ne connaissait visiblement pas l’expression...
-
« Oui, pouvoir lire Shakespeare en VO est une puissante motivation pour apprendre l’anglais. »
Certes. Maintenant dites-moi : combien de gens qui apprennent l’anglais dans les établissements scolaires (faute de choix) sont mûs par cette motivation ? Et comment peut-on vouloir apprendre une langue pour lire tel ou tel écrivain sans rien connapitre de lui ? La première connaissance se fait par les traductions.
« Ceux d’entre vous qui me répondent que »des traductions des classiques existent« ont-ils déjà pris la peine de lire le même livre dans sa langue originelle et dans sa traduction ? »
Oui. En tant que personne pouvant lire en VO en plusieurs langues, j’affirme que si une part de l’intraduisible est toujours présente, son importance n’est pas si élevée que ça.
Et puis, pourquoi toujours Shakespeare ? Et les autres classiques des autres pays ? Qui serait capable de les lire tous en VO ? Sans oublier que l’apprentissage d’une langue jusqu’à un niveau permettant de retirer le plaisir de la lecture, apprecier les nuances au lieu de peiner avec le dico et buter sur des mots inconnus et des expressions difficiles à saisir, demande beaucoup de temps. Alors ne dénigrons pas la traduction, c’est elle qui nous offre l’ouverture sur les autres cultures.
-
Bien sûr la traduction est indispensable, encore faut-il qu’elle soit bonne et j’irai preque jusqu’à dire remise fréquemment au goût du jour. Une traduction est vite datée quand elle se fait dans une langue qui évolue rapidement. Certaines traductions anciennens gardent cependant un intérêt historique, même si elles ne sont pas excellentes.
-
Evidemment, les traductions doivent être bonnes, mais cela va de soi, comme pour n’importe quel métier. Pour la fréquente remise à jour, ça dépend - Molière se lit bien, ce qui n’est pas le cas de Rabelais, et mettre le vocabulaire trop actuel dans un roman de Hugo ne serait pas vraiment indiqué

-
N’en déplaise à MrSel , au mois de juillet, j’ai suivi un stage sur le théâtre en espéranto, et nous avons comparé deux traductions de Hamlet (Shakespire). L’une datant de la fin du XIXème, signée de Zamenhof en personne, et la seconde de l’Allemand Neweil, datant des années soixante. Bien que la version de Zamenhof soit un exploit, car la langue n’en était alors qu’à ses premiers balbutiments, il était très intéressant de constater l’évolution de la langue, plus riche, plus souple, plus expressive dans la deuxième version.
Etant donné mon niveau en anglais, je suis incapable de lire, et surtout de comprendre, ne serait-ce qu’une page de Hamlet en version originale. L’espéranto est donc un moyen, pour moi, d’aborder la littérature des cultures dont je ne maîtrise pas la langue, puisque la plupart des chefs d’œuvres littéraires ont été traduits, souvent avec talent, dans cette langue.
-
Voilà, pour la définition de culture, celle que donne l’Unesco : La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Cette définition bien que large est assez floue et ne précise pas (ou ne cherche pas à le faire) quelles sont les conditions indispensables pour parler de « culture ». Toutefois, beaucoup de ces caractéristiques manquent à l’espéranto : modes de vie, systèmes de valeurs, traditions et croyances. Le seul dénominateur commun à la communauté « espéranto » est donc la langue (c’est déjà beaucoup) et les créations qui en résultent (romans, chansons, films). Est-ce suffisant pour autant ? L’expérience m’a montré que des personnes de même culture, lorsqu’elles sont expatriées, se regroupaient facilement, d’autant plus qu’elles vivent au quotidien une coupure avec leur propre culture qui en vient rapidement à créer un manque affectif plus ou moins traumatisant. Et là, on réalise que ce n’est pas seulement un problème de langue mais un problème de références. Le plus bel exemple en est le comique. Il n’y a qu’à voir un film comique français, à l’étranger, pour remarquer que les spectateurs étrangers ne rient pas aux mêmes moments que vous (non, ce n’est pas le décalage des sous-titres) ni pour les mêmes traits comiques. Et inversement, bien sûr, pour un film étranger vu par un français à l’étranger... Ces différences de références comiques ne toucheraient toutefois que les mots. Les gestes comiques, les situations comiques paraissent assez universels (Mr Bean souvent programmé dans les avions pour un public international). Un prof de la Sorbonne nous disait : la culture commune c’est quand je vous dis « chers amis bonjour », vous me répondez avec un bel ensemble bien rythmé : « bonjour » (allusion à l’émission « le jeu des mille francs » diffusée à la radio pendant des dizaines d’années). C’est un peu simple, mais parfois les choses simples sont plus profondes que les longues dissertations. Raison de plus pour m’arrêter là.
-
L’auteur
« Toutefois, beaucoup de ces caractéristiques manquent à l’espéranto : modes de vie, systèmes de valeurs, traditions et croyances. »
Heu ? Les modes de vie diffèrent, mais les valeurs sont proches. En théorie, l’espéranto peut être adopté dans n’importe quel usage, néonazis, commerce illicte, etc., mais en pratique, pour l’étudier et souhaiter son développement, il est probable qu’il faille partager certaines valeurs d’humanisme, etc. Des traditions, il y en a, ne serait-ce que des symboles tels que l’étoile verte, et surtout les conventions annuelles. Ainsi, selon votre message, nous n’aurions pas droit à l’appellation de culture au motif que sur la longue liste de critères établies par votre ex-prof, il nous en manquerait un seul, celui de partager un mode de vie, de vivre ensemble ?
En somme, tout le monde pourrait se revendiquer du mot culture, sauf les espérantistes : culture hippie, culture rock, culture black, culture olympique, culture rugbystique, culture paysanne (qui ne vivent pas tous ensemble), culture des banlieues, culture gay, etc, etc.
Non, je partage l’avis d’Espérantulo : le seul fait d’exister, à l’écrit ou à l’oral, et depuis un siècle, nous donne droit au « label cultureux » !
-
Si je reprend la definition de l’auteur sur la culture qu’elle doit contenir tout un ensemble de choses, si on dit que l’eo n’a pas de culture parce qu’il n’a pas de tradition, alors toutes les langues orales n’ont pas à avoir le nom de culture car elle ne pessèdent pas d’écrit, sa va ravir l’unesco ca !!!!!!!!!
-
« culture hippie, culture rock, culture black, culture olympique, culture rugbystique, culture paysanne (qui ne vivent pas tous ensemble), culture des banlieues, culture gay, etc, etc. »
« Culture pub ». Et pourtant, ses créateurs ni ses spectateurs ne vivent pas ensemble, et pour les traditions, il faudra repasser

La définition de l’UNESCO n’est pas aussi large pour rien. Sinon il suffit d’établir une liste, déclarer qu’il faut possèder toutes les caractéristiques de cette liste, et on se retrouve avec tout plein de cultures « fausses ».
Faut-il absolument « habiter ensemble » ? Diriez-vous le le yiddish n’a pas de culture, parce que ses locuteurs ne vivent pas ensemble ?
Les francophones ont-ils tous les mêmes traditions, les mêmes références culturelles ? Et les anglophones ? Et bien d’autres dont les modes de vie, les traditions diffèrent ?
L’exemple de l’humour n’est pas très pertinent, parce que certaines références deviennent obscurs même pour une autre génération, et si une personne ne regarde pas tel un tel jeu télévisé, est-il mis automatiquement en dehors de sa culture ?
Les espérantistes ont des mots bien à eux, des références humoristiques spécifiques, tout en restant ouverts sur l’ensemble des cultures.
-
les systèmes de valeurs, traditions existent dans la culture espérantophone aussi. Vous dites « des personnes de même culture, lorsqu’elles sont expatriées, se regroupaient facilement [...] elles vivent au quotidien une coupure avec leur propre culture [...] ». Alors, les espérantophones cherchent ces situations « d’expatrié », pour pouvoir apprendre à connaître une autre culture que celle d’où on vient, sans toutefois vivre une coupure avec sa propre culture. On reçoit et on donne. C’est justement l’outil d’immersion directe et totale dans une culture différente, échanger, en utilisant ce moyen de communication neutre par rapport à tous les interlocuteurs, et qui est facile à apprendre.
La culture de l’espéranto est cet intérêt, ce désir de découvrir l’autre, de partager, tout cela sur pied d’égalité car on a fait chacun de nous ce petit effort d’apprendre une langue inter-ethnique, qui permet d’avoir des contacts en plein respect des autres, communiquer en utilisant une langue neutre par rapport à tous les peuples du monde.
Des références (culturelles) existent dans la communauté mondiale des espérantophones aussi, elles sont nommées : respect, tolérance, curiosité, égalité de chances, intérêt vis-à-vis de l’autre, neutralité, relations democratiques, entraide etc.
A lire plus sur les droits culturels, en cliquant sur le lien suivant :
-
Il est vrai que le mot culture est un peu employé à toutes les sauces aujourd’hui et vous avez raison de citer la culture « footballistique » (ah, non, c’est le rugby que vous citez) un peu comme une caricature. Je crois, pour ma part, que ce qu’on peut comprendre comme culture se situe par rapport à un individu déterminé et ne peut pas être multiplié indéfiniment. Je m’explique : on naît dans une culture disons française (qui implique donc langue, littérature, mode de pensée, etc, etc.). On peut, grâce à des circonstances favorables en intégrer une deuxième, voire une troisième (père et mère de culture différente, résidence prolongée dans un autre pays, etc...) mais cela me semble être un maximum compte tenu de la difficulté de la chose. J’ai constaté que le seul bilinguisme (le vrai qui ne passe pas par la traduction mentale, dans lequel on parvient à penser ou à rêver dans deux langues différentes) est déjà assez rare. Il est généralement accompagné d’un léger moins dans les deux langues (bien que l’ouverture d’esprit soit un plus qui compense largement). Même si un enfant est capable d’assimiler beaucoup de langues sans effort, il les oublie aussi vite, sans même qu’il n’en reste la moindre trace (n’en déplaise au docteur Freud), s’il ne les pratique pas régulièrement. Ceci pour dire qu’une culture, pour moi, ce n’est pas appartenir à une équipe de rugby, c’est un système de pensée globale et, malheureusement, on ne multiplie pas ses systèmes de pensée si facilement. Alors je vous pose la question : rêvez vous en espéranto, pensez-vous parfois en espéranto , ou alors passez-vous par une « traduction mentale » chaque fois que vous-vous exprimez dans cette langue ?
-
« Alors je vous pose la question : rêvez vous en espéranto, pensez-vous parfois en espéranto , ou alors passez-vous par une »traduction mentale« chaque fois que vous-vous exprimez dans cette langue ? »
Oui j’ai déja rêver en espéranto pas lontemps mais quand même. penser en esépranto oui tres souvent. Je passe en traduction mentale quand je cherche un mot que je n’utilise pas et cette traduction est beaucoup plus facile dans certains cas que quand je cherche un mot dans ma propre langue maternelle. Une autre facon quand je cherche à traduire en anglais, de temps en temps surtout quand je but sur ma phrase la traduction spontané que je fais est en espéranto. mais pour en arriver à cela il faut quand même avoir une pratique assez courante de la langue et quel que soit la langue anglais, allemand, italien, esperanto.
Bien sur tout chose qui s’éfioche s’oublie par la non pratique et plus le chemin vers la parole est semé d’embuche par les exeption et compagnies et plus facilement l’oublie arrive. certains retiennent mieux que d’autres ca rils ont des aptitudes et surtouts des habitudes bien ancrées, l’avantage de l’eo c’est l’inexistance d’exception et la combinaison des racines prodigieuses qui fait qu’elle reste plus longtemps en mémoire que les autres langues à temps égale de pratique.
Bon on pourrait diserter des heures sur le sujet, car tellment il y a de choses à dire
-
Ayant travaillé en tant que prof d’espéranto à plein temps, pendant 4 ans, j’ai vraiment eu la possibilité d’expérimenter et de vivre « dans cet état » de penser, rêver et parler seulement en espéranto 24h/24. J’avais mon appartement dans un centre international espérantophone qui proposait des cours, conférences et séminaires, ou tout simplement des vacances aux espérantophones (ou aux débutants) venant de différents pays, d’autres continents aussi. Non, ca n’a pas été de la traduction mentale, c’était du « live », « en direct » en Eo. Et un espéranto « fluent »... pas besoin de réfléchir à la construction des phrases ou chercher, traduire des mots. Quand on est dedans, on y est comme vous en français, le sénégalais en wolof ou l’inka en quéchua.
Aujourd’hui aussi, quant je pense aux choses liées à l’eo, je « switch » (automatiquement) à l’espérantophone et ca se passe tout naturellement et en esperanto ekskluzive.
Le plus simple de l’expérimenter ce qu’on vit quand on le parle, c’est de l’apprendre, mettez-vous y, ce n’est pas difficile, ni long à faire. On est là pour vous conseiller ou vous donner un coup de main dans l’apprentissage. (avec le « oueb » et les mp3, c’est rapide, facile et efficace...). Juste pour avoir l’expérience personnelle.
Ensuite, disons, dans un mois, on pourra continuer la discussion entre connnaisseurs... En attendant, ce n’est que des suppositions, idées faites et des spéculations de l’extérieure... (en tout cas concernant ceux qui ne l’ont jamais appris).
Nu, komencu !

-
Je suis entièrement d’accord avec vous pour dire que la culture est employée à toutes les sauces, et qu’elle se situe par rapport à un individu déterminé.
En fait il y a autant de cultures que d’individus, car cela dépend de bien des facteurs : milieu linguistique, milieu social, milieu religieux, études réalisées, expériences personnelles, intérêts personnels, etc., etc.,. Personnellement j’ai une culture tout à fait différente de celle de ma soeur et de mon frère. L’on n’est plus au moyen âge où les habitants de toute une région avaient la même culture.
Qaunt à savoir si je rêve en espéranto, cela m’arrive, oui, comme je rêve aussi très souvent en néerlandais, bien que je sois francophone, mais domicilié en région flamande.
Par ailleurs, lorsque je m’exprime en espéranto, il n’y a aucune « traduction mentale » ; je pense et je m’exprime directement en espéranto, ce qui n’est jamais le cas lorsque je dois le faire en anglais. Il est vrai que j’utilise quotidiennement l’espéranto (et le néerlandais) depuis plus de trente ans, alors que cela m’arrive très rarement en anglais.
-
Une petite citation de Louis Lumière, inventeur du cinéma :
« L’emploi de l’espéranto pourrait avoir les plus heureuses conséquences en ce qui touche les relations internationales et l’établissement de la paix. »
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON














 ) !
) !
