Exorcismes spirituels pour en finir avec Kant et Newton

La vie de tous les jours n’offre pas l’occasion de s’interroger sur des choses qui en leurs temps, ont occupé les penseurs les plus savants. Parmi les grandes interrogations, les unes concernent l’existence de l’univers. Pourquoi quelque chose plutôt que rien se demandait Leibniz. Kant n’avait pas ce genre de questionnement en ligne de mire. Il se demandait comment les choses se livrent à la sensibilité et comment elles peuvent devenir intelligibles et construisit la théorie de l’idéalisme transcendantal. Il y a un sujet kantien, ce qui suppose que d’autres « sujets » ont été pensés et conçus par la philosophie moderne. Le sujet cartésien mais aussi et surtout le sujet husserlien. Kant et Husserl ont tenté de comprendre le rapport entre les objets et le sujet cognitif. Comment monde est-il accessible à une connaissance par concepts ? Kant est connu pour avoir amené une « révolution copernicienne » en matière de philosophie de la connaissance. Un peu plus d’un siècle après, Husserl accomplit lui aussi un geste philosophique dont l’interprétation ne fait pas consensus. Husserl a-t-il perfectionné le sujet kantien ou bien emprunté une autre voie ? Dominique Pradelle penche pour la seconde option et nous explique les raisons dans un gros livre intitulé Par-delà la révolution copernicienne ; et sous-titré Sujet transcendantal et facultés chez Kant et Husserl (PUF, mars 2012). Bien évidemment, ce livre ne vous expliquera pas comment trouver un emploi ou bien effectuer un bon placement. Il répondra à la curiosité de ceux pour qui l’existence ne se résume pas seulement à faire avancer des machines ou une carrière mais se déroule en cheminant à travers des étonnements, des questionnements, sur le monde, l’homme, la conscience et le lien entre la faculté de connaître et les objets s’offrant à l’expérience de la conscience et du vécu. Les objets peuvent être expérimentés par la science, auquel cas on parle d’épistémologie. Lorsque ces objets sont connus par une conscience attentive et rigoureuse, il mieux vaut employer le terme de gnoséologie. Mais au fait, quelle est cette instance qui connaît, perçoit, entend le monde et ses objets ? C’est le sujet disent les philosophes modernes. Néanmoins, ce sujet préformé qui se veut transcendantal pour Kant se constitue par un procédé bien différent chez Husserl. Dans son essai, Dominique Pradelle tente de nous expliquer comment un basculement « gnoséologique » s’est dessiné au sein d’une phénoménologie dont l’interprétation ne suit pas une voie univoque comme on s’en aperçoit en consultant les nombreuses gloses universitaires sur la philosophie de Husserl.
La question posée concerne l’origine du sujet, sa genèse avec l’émergence de ses facultés cognitives en relation avec l’expérience du monde. Quel sujet, quelles relations avec l’objet, quel rôle attribuer à ces objets dans la genèse du sujet qui accède à leur « aspect essentiel » ? La démonstration de Pradelle est convaincante et même si l’ouvrage n’est pas d’un abord facile, il livre des explications essentielles sur la manière dont se constitue et fonctionne pour ainsi dire le « sujet connaissant le monde avec ses étants ». Et c’est sur ce point que la différence radicale entre Kant et Husserl se dessine. En simplifiant le propos, on peut affirmer que chez Kant c’est un sujet accompli qui est prêt à fonctionner alors que pour Husserl, le sujet se fait en fonctionnant. L’essence du sujet pur se produit à partir de la production de ses objets catégoriels. Telle est en résumé la thèse défendue par Pradelle sur la base d’une investigation philosophique très détaillée. Comme dans toute étude roborative, on trouve de longs développements au sein desquels on peut trouver, tel un minerai extrait de la gangue, un ensemble de lignes décisives explicitant en un clin de lecture le contenu de la thèse qui se développe. Ces lignes, on les trouve par exemple au début du chapitre 5. La phénoménologie conduirait ainsi à déconstruire le sujet kantien en revisitant le fonctionnement du doublet empirico-transcendantal. Le sujet moderne n’a cessé en effet d’osciller entre deux pôles, celui de l’expérience, des phénomènes, de l’empirique et celui de l’intériorité, du sujet rationnel entendant, connaissant, conceptualisant et concevant. Ces deux pôles constituent un dipôle structurant, sorte de « limaille intellectuelle aimantée » attirant les notions qui en émanent. On y trouve des doublets, comme concret et abstrait, percevoir et concevoir, sensibilité et entendement et enfin, le fameux doublet kantien ordonnant les facettes du sujet autour de l’a posteriori et l’a priori. Le livre qui nous est offert raconte la désubjectivisation du sujet kantien par Husserl.
Positionnement de la phénoménologie transcendantale sur la topique ontologique
Dominique Pradelle expose autant un renversement copernicien qu’un déplacement de « l’espace ontologique » constitué par l’entrelacs réunissant et scindant le monde phénoménal des objectités et le « monde intelligent » du sujet, avec en supplément un élément indéfini apparaissant comme ego pur ou bien conscience pure. Ces trois éléments peuvent être placés sur un axe ontologique que j’ai extrait d’une étude de Kojève sur la philosophie antique (Dugué, L’expressionnisme, prolégomènes à une métaphysique des temps nouveaux). La structure universelle comprend trois lieux qu’on peut schématiser en élaborant une sorte de topique qui n’est pas freudienne mais ontologique, une topique qui simplifie la représentation, un peu comme les diagrammes de Feymann en physique. Les trois lieux se déclinent comme (i) onto-logie, lieu de l’Etre et son essence ; (ii) l’énergo-logie, lieu du sujet en procès et son essence, autrement dit, l’essence du processus et le processus de l’essence au sein du sujet ; (iii) la phénoméno-logie, lieu des objets phénoménaux et de leur essence. L’intérêt de ce schéma est de visualiser où se situe la césure « ontologique » dans une pensée métaphysique. On peut situer ainsi l’un des axes fondateurs des disputes philosophiques opposant Platon et Aristote dont voici la traduction sur le diagramme.
Platon : Onto-logie <-> énergo-logie // phénoméno-logie
Aristote : Onto-logie // énergo-logie <-> phénoméno-logie
Brièvement, chez Platon, l’onto-logie représente l’intelligible, le cosmos noétique, dont se rapproche le sage philosophe au terme de son développement, alors que le sensible est éloigné. Chez Aristote, une continuité existe dans la chaîne des étants, avec le monde de l’âme articulé au monde matériel, dans le contexte de la dualité forme matière, tandis que l’univers onto-logique est lointain, inaccessible monde supralunaire avec son premier moteur. J’applique les deux doctrines du sujet transcendantal, celles de Kant et Husserl, sur ce schéma. Commençons par Kant dont le sujet dispose d’un entendement intuitif autonome dont l’origine est indépendante de la réceptivité des objets (Pradelle, p. 86). Au sein du sujet kantien s’opère une véritable césure entre l’esthétique et la logique, entre la science des principes de la sensibilité et la science des règles de l’entendement ou alors des principes de la pensée pure (p. 102). Les idées transcendantales s’articulent autour d’une raison dont le mode opératoire est indépendant du monde de réceptivité des objets. La théorie kantienne réunit ainsi l’énergo-logie de l’entendement et l’onto-logie de la raison et pensée pure en une unité autonome sur laquelle le monde phénoméno-logique des objets s’ajuste en se dépouillant néanmoins de l’élément « logique », c’est-à-dire de la chose-en-soi qui reste cachée alors que l’objet n’est plus perçu que comme sensibilité, bref, comme une sorte de « dépouille matérielle » privée de sa structure eidétique. Cette sensibilité est l’espace où transite l’univers kantien de l’a posteriori alors que l’a priori relève de l’espace transcendantal du sujet, celui de l’onto-énergo-logie. La césure est donc au même niveau que Platon mais au lieu d’un cosmos noétique, nous avons un sujet noétique chez Kant, un sujet qui, pour reprendre le propos de Pradelle, est théologisé. La césure kantienne opère notamment en scindant entendement et sensibilité, spontanéité et réceptivité, activité et passivité. Tout se passe comme si le sujet s’ouvrait au phénomène pour le recueillir tel un liquide épousant la forme du vase spirituel qui devient à son tour une forme de l’entendement sur laquelle opère une raison active. C’est cette scission qui est neutralisée par Husserl. On peut alors évoquer une sorte de « complicité ontologique » retrouvée entre le sujet et le monde, un entrelacs réunissant l’énergo-logie et la phénoméno-logie, si bien que l’a posteriori cesse de s’identifier à la réceptivité des impressions et l’a priori a des structures toutes prêtes dans l’esprit et précédant la donation des objets (p. 177).
Ainsi, la phénoménologie élaborée par Husserl s’inscrit dans le diagramme un peu comme la métaphysique d’Aristote. Il n’y a plus la scission entre le monde énergo-logique du sujet et le monde phénoméno-logique. J’emploie la notion d’encarnation pour expliciter la méthode husserlienne dont le principe apparaît clairement et synthétiquement dans le chapitre cinq (p. 170). Le concret et l’abstrait deviennent des caractères structurels des contenus de représentation, c’est-à-dire des noèmes. Plus précisément, c’est une partie du dispositif scindé par Kant qui se retrouve réunie au plan des objets même, c’est-à-dire au niveau noématique où sont associés pour être détachés par la « décomposition phénoménologique » le concret et l’abstrait, l’a posteriori et l’a priori. La structure des contenus noématiques sert de fil conducteur pour établir les distinctions subjectives, autrement dit ce qui est du côté du sujet énergo-logique et ce qui relève du monde représenté et intuitionné. La thèse kantienne des objets s’ajustant sur le sujet est donc réfutée. Le sujet transcendantal est de plus désubjectivisé. Ce qui ne veut pas dire que le sujet disparaît mais que les facultés subjectives prennent racines dans les structures eidétiques contenues dans l’intuition, autrement dit en interdépendance avec la manière dont l’objet se donne à la conscience. Pour le dire avec une formule allégorique, le sujet se constitue et s’enrichit grâce aux dons effectués par les objets. Et pour conclure ce volet avec une formule philosophique, ce propos du chapitre cinq sur le sujet transcendantal qui se laisse définir comme le « reflet transcendantal de l’architectonique ontologique des types d’objets ». Je traduis cette énigmatique formule pour le profane en suggérant de considérer l’entrelacs du sujet entendant sous l’angle d’une matérialité réflexive, autrement dit une structure de type miroir qu’offre le champ matériel et qu’on peut déduire de la mécanique quantique (Dugué, Le kantique des quantiques, manuscrit à éditer). Alors que dans le champ des sciences cognitives, cette formule nous entraînerait vers la découverte récente des neurones miroirs. C’est un peu comme si l’objet pouvait se voir en se reflétant dans le sujet.
Le sujet phénoménologique, la connaissance des objets et l’inscription du sujet gnoséologique dans le monde face à l’énigme ontologique.
Après le repositionnement du dispositif articulant sujet et monde, Pradelle nous invite à une investigation ardue où la dimension du temps intervient, ce qui amène naturellement à des considérations d’ordre généalogique et téléologique, notamment sur un sujet voué au « remplissement gnoséologique », thématique permettant de séparer Kant de Husserl. Pour le premier, le caractère a priori des formes conceptuelles semble figer le processus de catégorisation d’un monde qui, devenant monde conceptualisé dans le sujet, suit la route tracée par les a priori. Husserl ouvre la voie vers une autre possibilité, celle de la contingence ontologique, autrement dit, celle du voyageur qui part à la rencontre du monde et s’en remet au « cours empirique des données sensibles » (p. 300). Cette possibilité marque inévitablement une connivence entre Nietzsche et Husserl, connivence explicitement évoquée par l’auteur à propos de la déduction téléologique des catégories ouvrant vers une connaissance au service de la vie (p. 347). On peut même se demander si l’intention de Pradelle n’est pas de construire un pont menant de Husserl vers un Nietzsche revisité à travers une généalogie de la raison ? Tel semble être le projet annoncé par l’auteur dans la préface, puis rappelé dans les dernières pages de l’ouvrage avec cette formulation qui ressemble bien à du Nietzsche tout craché : « morte la subjectivité, morte la divinité » (p. 387)
Pour le reste, l’ontologie n’est pas oubliée, s’invitant à l’occasion de questions sur l’universalisation de la raison et les a priori de corrélations ordonnant les moments eidétiques du vécu. La désubjectivisation se poursuit donc cette fois avec un questionnement plus fondamental qui se veut aussi « fondemental » et global, concernant l’être et le devenir du sujet transcendantal tel qu’il se dessine dans la phénoménologie husserlienne. Comment se constitue le sujet, comment accède-t-il aux savoirs des objets et de quelle manière l’entendement phénoménologique se sépare de l’entendement scientifique ? Ces interrogations font l’objet des chapitres six et sept de l’ouvrage avec comme thématique centrale le renversement opéré par Husserl dont la conception du sujet se veut dynamique et évolutive alors que chez Kant, tout semble figé dans le jeu des formes et concepts a priori. Les deux pôles essentiels de la connaissance sont ainsi examinés à travers les études phénoménologiques, premièrement, la connaissance des objets, de leur manière dont ils se donnent et/ou se conceptualisent grâce à l’expérience de la conscience ou bien scientifique ; deuxièmement, l’auto-compréhension du sujet avec ses facultés de créer et d’ordonner les concepts.
Dans des pages éclairantes, Pradelle explicite la différence radicale entre les deux modes de relation aux objets, celui utilisé par la science moderne et celui pratiqué par la conscience phénoménologique. L’objet face à l’entendement phénoménologique n’est pas l’objet de l’entendement scientifique. D’où deux dénominations, celle d’objectualité et celle d’objectivité. Pour Husserl, les conditions d’objectualité ne s’identifient pas à celles de l’objectivité et sont de surcroît plus faibles. La condition d’« omni-objectivité » à laquelle se soumet la science est en effet plus forte, plus contraignante. Le propre de l’expérience scientifique est d’être reproductible partout dans le monde et en tous temps. Quelle est donc cette différence radicale ? Je vais l’exposer à ma manière. Prenons par exemple un objet de couleur rouge. Un individu décrit la perception qu’il en a, affirmant à son entourage que l’objet est rouge, et comme on s’y attend, les autres confirment que cet objet est bien rouge. Mais rien n’interdit de supposer qu’un autre individu, par exemple dans une peuplade amazonienne, affirmera que le rouge est bien la couleur de l’objet. On comprend la faiblesse de l’évidence objectuelle phénoménologique. Mais la science, comment garantit-elle l’omni-objectivité ? Eh bien grâce à l’usage d’appareils de mesure et en l’occurrence, un spectromètre qui, placé face à l’objet, indiquera la fréquence d’émission exacte. C’est une quantification qui, en plus d’être d’une précision infaillible, livrera les mêmes résultats dans les mêmes conditions si l’expérience est réalisée ailleurs. L’objectivité scientifique n’est donc pas phénoménologique mais technique. La relation expérimentale scientifique ne fournit pas l’objet réel mais la trace de cet objet sur le dispositif matériel où il s’inscrit. Et c’est par ce procédé qu’est née la physique mathématique de Newton. Les masses laissent une empreinte sur une trame spatiotemporelle façonnée par l’homme. L’espace-temps newtonien n’existe pas comme réalité, ce n’est qu’une construction rationnelle rendue possible par la mesure des intervalles spatiaux et temporels. La nature perceptive n’est donc pas constituée par les mêmes catégories que la nature mathématisée (p. 293). Ces réflexions sur l’entendement scientifique sont développées dans le chapitre sept avec la conclusion sur le sens de ces constructions formelles de la science résolument éloignées de l’intuition phénoménologique : ce sens est hétéronome et détermine l’orientation occidentale d’une science qui sert la finalité de domination complète de l’homme sur la nature. Finalement, ce constat ressemble sur quelques points d’exposition à celui effectué par René Guénon dénonçant cette voie prise par l’Occident tout en l’opposant à une pensée intellectuelle orientale. Et l’on se demande si la phénoménologie ne conduit pas vers un rapport au monde présentant des similitudes avec les pensées orientales, indiennes, chinoises ou japonaises.
Par delà ces considérations sur la science, Pradelle trace une thèse sur l’homme et le monde, une thèse que je suggère d’énoncer comme un « monisme ontologique de l’expérience phénoménologique et du processus gnoséologique effectués par un sujet transcendantal désubjectivisé ». La vision du monde n’est plus celle des anciens avec le triptyque phéno-, énergo- et onto-logie, ni celle des modernes avec la nature, l’homme et Dieu, mais une sorte de monisme qui néanmoins, se dessine sous forme d’un triptyque avec trois catégories de processus entrelacés fonctionnant avec trois types d’a priori, noématique, noétique, corrélation (voir conclusion p. 368). En fait, les trois domaines gnoséologiques sont entrelacés et non scindés comme dans la coupure aristotélicienne ou platonicienne (voir plus haut). Ces trois a priori ont le statut d’éléments qui peuvent être reconnus par le sujet et bien entendu, servant aux facultés gnoséologiques du sujet qui en dispose mais, et c’est le point important de la conclusion de Pradelle, ces éléments ne sont pas instaurés par le sujet, qu’il s’agisse des a priori noématiques donnés par l’objet ou des a priori noétiques dont les lois ne sont pas fondées par l’activité du sujet ou enfin des a priori de corrélation dont les règles accordant les types d’objet et les modalités subjectives dont indépendantes de la nature du sujet (p. 369). Ces hypothèses sont extrêmement fortes, amenant le champ de l’intellectualité vers une universalité qui ne ressemble pas à celle des Lumières et de Kant. On verra quelques parentés avec le monisme spiritualiste de Hegel (avec ses trois logiques) ainsi qu’avec Leibniz avec quelques présupposés innéistes qu’on retrouve aussi chez les mathématiciens platoniciens. Reste la question de l’absolu phénoménologique qui d’un point de vue architectonique, doit prendre place au niveau de l’a priori de corrélation.
Ces considérations sur l’absolu du « dispositif de corrélation » conduisent vers des interrogations fondementales sur l’origine des processus gnoséologiques se déroulant dans le sujet phénoménologiques. Qu’est-ce qui provient du pôle objectuel et de celui du sujet ? Pradelle expose une tension entre deux thèses tout en envisageant une troisième voie (p. 373). Ces conjectures sont d’une difficulté extrême, enfermant la réflexion dans un cercle vicieux entre l’en-soi et les objets, entre le sujet et l’étant. On s’interroge alors sur « Qui » dispose de la maîtrise des processus noématiques et noétiques. Et donc deux options selon Pradelle, ou bien chercher à remédier à ce qui semble provenir d’une faute de raisonnement conduisant à un cercle logique vicieux, où bien accepter ce cercle comme un élément constitué essentiel de la pensée et chercher à penser cette condition comme le fait Heidegger, ce qui impose de distinguer les objets naturels (ou de la nature perceptive) et les objets culturels. Cette supposition est riche de sens et l’on voit la distinction entre sciences de la nature et science de l’esprit formulée par Dilthey se dessiner au sein même de la philosophie, en toute indépendance avec la science moderne puisque cette distinction est opérationnelle au sein même d’une phénoménologie qui, et c’est l’enjeu du siècle, semble découvrir une nouvelle dimension du temps, à la fois dans le mode de perception des objets naturels que le mode de compréhension des objets culturels. Peut-être alors pourrions-nous recadrer la phénoménologie dans son époque, la situer en relation avec cette autre découverte du temps, celle liée à l’entropie mais aussi la trame temporelle découverte par Darwin mais aussi, sur le plan de la théorie de la conscience et de l’apparaître des objets, tracer des jonctions avec les mécaniques quantiques appliquées aux champs et aux trous noirs.
Sur le plan phénoménologique, l’ouverture passe par Heidegger dont l’ultime philosophie l’a conduit vers quelque accointances avec le bouddhisme. On ne sera pas étonné de constater les connivences entre la phénoménologie et la théorie de l’éveil à soi bâtie par un contemporain de Husserl, Nishida Kitaro et ses trois bashos, de l’être, de l’oppositionnel et du néant absolu « intelligible », pouvant correspondre sans s’y identifier aux structures noématiques, noétiques et à la conscience donatrice absolu. Beaucoup de travail en perspective mais au bout, un enjeu sur la place de l’individu dans notre Occident en crise. Avec un autre défi, le passage de la phénoménologie au réalisme transcendantal, versant objet et versant universel incluant la mystique (kabbale, néoplatonisme, soufisme). En résumé, on peut penser qu’en prenant la phénoménologie comme levier, on verrait apparaître deux choses. D’abord la non unicité de la manière de voir scindant les Occidentaux et les Orientaux, ensuite au sein même de l’Occident, une histoire du regard, pour reprendre une formule de Carl Havelange.
Au sein de cette histoire, nous voyons se dessiner de manière proéminente le moment rationaliste, à la foi philosophique et scientifique, associant Newton et Kant. C’est un moment clé de l’Occident, avec comme principe structurant le réglage. L’univers subjectif kantien, tout comme celui objectif de Newton, repose sur le réglage. Ce principe va jusqu’à fonctionner dans la nouvelle théologie des Lumières, celle propagée dans les cercles maçonniques et partagée par les élites qui, suivant Voltaire, se voulaient déistes et vénéraient le Grand Architecte. La métaphore de cette époque, c’est celle de l’horloger. Et en effet, quoi de mieux que les rouages d’une montre pour évoquer les réglages universels, une montre qui, trouvée par un étranger, fut à l’origine d’une fameuse méditation de William Paley sur la mécanique du vivant. Nous n’en avons pas fini avec cette question du réglage, qui fut pour l’Occident un Janus où le salut par le progrès technique fut entrelacé avec une malédiction spirituelle. A se demander si Kant n’aurait pas été empoisonné par la mécanique newtonienne. Auquel cas, Husserl pourrait constituer un contrepoison fort utile, surtout par les temps qui courent. Le regard phénoménologie institue une nouvelle ère dans la manière de penser les objets et semble étroitement lié avec les résultats de la physique quantique qui, à peu près à la même époque, on permis de déconstruire l’objectivité newtonienne, avec la cosmologie relativiste.
Exorcismes spirituels avec Husserl. Un clin d’œil on l’aura compris aux exercices spirituels proposés par les jésuites et que pratiqua un certain Descartes pour ensuite rêver à la saint Martin d’une nouvelle science dont on voit l’aboutissement. Cette science n’était ni avec ni contre Dieu d’après l’interprétation que Descartes fit de son rêve. Et maintenant, cette « science et philosophie moderne », perfectionnée par Newton, Kant, puis la biologie réductionniste, nous savons qu’elle est à la fois un salut pour l’homme et une malédiction. Ce dont nous avons besoin, c’est d’exorcismes spirituels pour en finir avec Kant et Newton. Peut-être qu’un autre type de réglage, celui de l’harmonie, peut nous conduire à démonter le démon occidental. La musique serait-elle aussi un exorcisme ?
Bernard Dugué, le 30 mai 2012
Documents joints à cet article
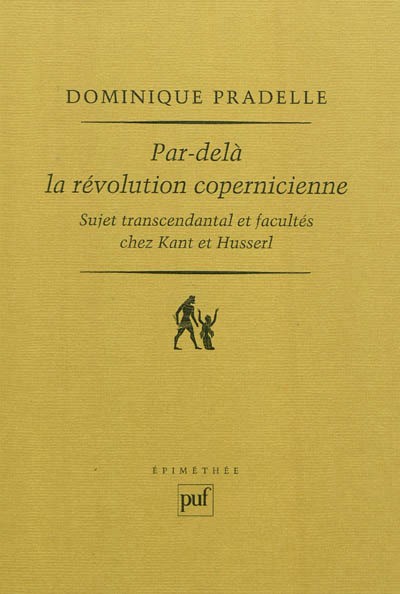
57 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON









 , modestie pas seulement sur nos possibilités de mesures du temps...
, modestie pas seulement sur nos possibilités de mesures du temps...

