Dans le mystère Jésus, la question qu'il faut se poser est la suivante : et si c'était nous qui n'aurions pas compris ce que les évangiles ont voulu nous dire ?
Jérusalem est peut-être, avant la destruction de 70, le lieu du monde dans lequel on aurait trouvé la plus forte densité de gens instruits sachant lire et écrire, et nourris d'une abondante littérature théologique écrite. Cette phrase sera mon introduction. Elle nous incite à l'humilité. Elle est du professeur Claude Tresmontant. Le langage populaire était alors l'araméen mais dans le cercle savant des élites, on écrivait encore en hébreu. On pensait encore en hébreu, dans la continuation des anciens textes écrits.
Or, qu'est-ce qu'un écrit sinon une parole ou un "parler" - suivant le mot de Claude Tresmontant - un parler que l'homme a couché sur un support pour le conserver mais qui reste néanmoins un parler. Pour nous, modernes, le "parler" n'est que le résultat d'un processus d'évolution. Pour les anciens juifs, outre que Dieu était une certitude, il ne fait pas de doute non plus que le parler venait de Lui. C'est par le "parler" que Dieu créa le monde. Dieu dit : que la lumière soit ! Jean le rappelle dans son prologue et il précise que "ce parler, chair il a été ; il a dressé sa tente au milieu de nous" (Jn 1, 14).
Un miracle amélioré et corrigé : la guérison du centurion

Je rappelle ce que j'ai écrit dans mon article précédent : On lit ceci dans les Actes des Apôtres (Act 10, 1-48) : Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italique... suit une vision où un ange lui apparaît pour qu’il invite Simon Pierre à venir le voir. Simon Pierre se trouvait à Joppé. S’ensuit à Césarée une rencontre dont le but est manifestement une tentative de conciliation qui, manifestement, n’a pu se faire qu’avec l’assentiment du roi Agrippa. « Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui, comme nous, ont reçu l’esprit saint ? ». C’est la conclusion de Simon Pierre qui sort de cet entretien avec l’impression d’avoir sinon converti, au moins obtenu une promesse de tolérance.
Nous avons là un texte pour ainsi dire brut de décoffrage qui correspond à un événement réel. Pourquoi ce curieux nom de Corneille donné au centurion ? Probablement était-il le chef d'une centurie gauloise intégrée dans une cohorte italique mais ayant l'alouette pour enseigne. Avec un encadrement gaulois bien disposé qui devait se souvenir des fresques judaïques de Gourdon, près de Bibracte. Cent hommes pour garder une capitale, c'est raisonnable. Simon Pierre à Jaffa/Joppé (Tel Aviv) dans la maison d'un autre Simon travaillant le cuir pour mettre en forme les codex à diffuser dans la diaspora (?), nous sommes entre Esséniens. Bref, nous sommes dans le vécu.
Dans cette affaire, il n'y a pas de Jésus, mais une voix, là encore, qui s'adresse à Pierre dans un songe, puis un moment extraordinaire quand celui-ci, à Césarée, s’adresse à l’assemblée (la maison du centenier) : Au moment où je prenais la parole, rapporte-t-il, l'Esprit Saint s'empara de ceux qui étaient là, comme il l'avait fait au commencement pour nous (Act 10,15). Cette impression de l’apôtre est-elle due au stress ou à sa force de conviction qui fait qu’en récitant sa leçon bien apprise, l’orateur apôtre ait eu le sentiment qu’elle ait été dite par quelqu’un d’autre que lui ? Ajoutez à cela une ambiance quelque peu irréelle où les auditeurs échangent des propos dans une langue gauloise incompréhensible, et peut-être une atmosphère chaleureuse, le banquet aidant.
Toutes choses égales d’ailleurs, c’est bien ce que Pierre laisse entendre aux siens à son retour à Jérusalem, à savoir qu’il a l’impression, voire la certitude, que la Parole de Dieu s’est exprimée à travers lui.
La réaction logique des frères a probablement été d'en douter, d'en référer à Antioche et d'informer Paul. Il me semble que c'était bien le plus important. Or, curieusement, la version donnée, je ne sais pas pourquoi, est très différente. La seule question qui est posée à Antioche est de savoir s'il faut porter la parole aux nations (Act 11, 1-3).
La Parole de Dieu s'est-elle exprimée par la voix de Simon Pierre ? C'est la question qui aurait dû être relatée dans les Actes. Elle ne l'a pas été mais la réponse se trouve dans les évangiles de Luc et de Matthieu (Luc 7, 1-10 et Mt 8, 5-13). Comme je l’ai expliqué dans mon précédent article, ce "miracle" a été transposé et corrigé. Dans la transposition évangélique, ce n'est plus Pierre, c'est Jésus qui est dans Pierre qui agit. Mais attention ! que ceux qui ont des oreilles pour entendre les ouvrent bien grandes : Jésus n'entre pas dans la maison du centenier non circoncis, il ne mange pas avec lui. « Seigneur, lui dit le centurion/centenier, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » En effet, comme le centenier ne renonce pas à son allégeance à la déesse Rome, Jésus ne peut pas “théologiquement” le guérir ; il ne peut guérir que son serviteur. En outre, alors que Flavius Josèphe confirme la version des Actes qui situe la rencontre à Césarée, les correcteurs évangéliques ont estimé que ce n’était pas acceptable et ils ont décidé que le centenier viendrait faire sa supplique au temple juif de Capharnaüm.
Le roi Agrippa n’avait pas la réputation d’avoir un moralité irréprochable. On comprend que Simon lui ait interdit l’accès au temple comme l'écrit Josèphe dans mon précédent article
http://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/histoire-du-jesus-de-jean-baptiste-144786. Par ailleurs, je ne vois pas comment on peut interpréter le récit des Actes autrement que par une tentative de conciliation. Autorisée ou non par le roi, elle a eu lieu. Ceci étant dit, on doit s’interroger sur quelle a été sa réaction quand il a pris connaissance de la transposition évangélique qui montre le centurion se convertir à l'évangile, comme si c'était un exemple à suivre.
La réaction n'a pu être que violente. Et, en effet, la répression s’abat sur la communauté. Le roi Hérode Agrippa se met à maltraiter certains membres de l'Église (Act 12, 1). Un Jacques est lapidé. Pierre est emprisonné mais réussit à s’enfuir. Et puis, à la surprise générale, Agrippa meurt soudainement en 44, certains disent qu'il a été empoisonné. Et puis, en 48, Simon est crucifié sous le gouvernement de Tibère Alexandre (44 – 48). Flavius Josèphe a noté le fait. Nous sommes dans la logique de l’Histoire.
Mais nous sommes aussi dans la logique de l’élaboration des évangiles. Dans cet entretien de Césarée – les Actes des Apôtres y consacrent un long chapitre – la communauté essénienne/chrétienne s’est trouvée, de facto, dans la même situation que dans celle où se trouve aujourd’hui l’Église quand il s’agit de déterminer s’il y a guérison miraculeuse ou non.
Qu’on imagine le terrible dilemme qui s’est posé à la bonne foi de la communauté. D’un côté, il ne fallait pas occulter la Parole de Dieu qui avait cherché à s’exprimer dans cette affaire. D’un autre côté, il fallait l’épurer, voire la corriger, pour en extraire le vrai sens acceptable… énorme responsabilité !
Doute ou appel tragique : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
Pourquoi ce cri tragique que prononce sur la croix le Jésus de Marc du deuxième évangile avant d'exhaler son dernier soupir ? Ce cri que le roi David avait déjà clamé (Ps 22). Pourquoi le Jésus de Jean du premier évangile ne l'a-t-il pas prononcé avant lui ? Cette question, c'est à Jean-Baptiste qu'il faut la poser. Quelle était donc la pensée de ce Jean-Baptiste qu'Hérode Antipas se plaisait à écouter avant de lui couper la tête ?
parce que hôrôdôs [lui] il craignait iôhanan
et il savait que [c'était] un homme juste et saint
et alors il le protégeait et il l'écoutait
et il faisait souvent [ce qu'il disait]
et il aimait à l'entendre (traduction Cl. Tresmontant, Mc 6, 20)
Admettons que ce Jean-Baptiste ait été un individu, avec toutefois derrière lui toute la communauté essénienne de la région de la mer Morte, ou au moins une partie de celle-ci. Admettons que le Jésus, Christ, que Jacques voyait dans le ciel, dans son épitre, soit descendu dans la communauté comme le dit le fameux prologue. Soyons persuadé que Jean-Baptiste était conscient qu'en prêchant contre le Sanhédrin, il condamnait sa communauté à monter sur la croix. Alors s'expliquerait l'hypothèse qu'après avoir raconté l'histoire d'un Jésus anonyme agissant dans les membres de la communauté, Jean le fasse monter avec eux sur la croix… en espérant qu'il ressuscite dans l'un d'eux, car Dieu ne peut pas laisser mourir son fils. Dans cette hypothèse, la dernière partie de l'évangile de Jean serait une prophétie. Une prophétie qui comportait néanmoins deux possibilités de réalisation : un que Jésus se révèle sur la croix en ressuscitant en gloire comme l'avait prophétisé Etienne, deux qu'il ressuscite trois ans après dans un autre communauté, ce qui se réalisera dans l'évangile de Marc et ensuite dans celui de Luc. J'ai traité le sujet dans mes ouvrages ainsi que dans quelques articles. Je rappellerais seulement celui-ci
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-christ-est-il-ressuscite-a-128903 pour que l'on comprenne bien que l'évangile de Jean, sous l'apparence d'un récit tout ce qu'il y a de plus classique, baigne en réalité dans le symbolisme certainement le plus complexe de toute la littérature juive. Le plus étrange, mais aussi le plus facile à démontrer, est que Jean y raconte l'histoire d'un conseil comme s'il s'agissait de celle d'un homme, histoire d'un conseil galiléen entré en résistance.
Dans le premier évangile, Jésus encore vivant, ne pouvait pas reprocher à Dieu de l'avoir abandonné, dans le second, celui de Marc, il le pouvait.
Autre exemple de miracle transposé : Les pèlerins d’Emmaüs.
On lit ceci dans les Actes des Apôtres : L'esprit du Seigneur dit à Philippe : « Mets-toi en marche vers le midi, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza … Tu y rencontrera un Ethiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d’Ethiopie et surintendant de tous ses trésors, qui est venu adorer à Jérusalem ». Cet Éthiopien s’en retournait sur le chemin qui mène à Gaza et, assis sur son char (égyptien), il lisait le prophète Isaïe. Il y avait un passage prophétique qu’il ne comprenait pas. Philippe, qui l’accompagnait, lui expliqua alors les fabuleux événements qui venaient de se produire. Aussitôt l’Ethiopien crut et il demanda le baptême (Act 8, 26-40).
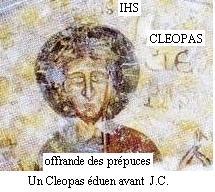
Dans l’évangile de Luc, la conversion de l’Éthiopien a été transposée comme sur un plan supérieur, modifiée et considérablement enrichie. Le personnage de Philippe s’éclipse au second plan tandis que Jésus, qui a rejoint les deux compagnons, se révèle par la fraction du pain. Quant à l’Éthiopien, l'ancêtre des Égyptiens, il devient Cléopas, le messie espéré des fresques de Gourdon, au pied de Bibracte, l’antique et vraie capitale de la Gaule (Lc 24, 13 -33).
Pourquoi cette longueur de récit inhabituelle consacrée à un événement que les Actes relatent beaucoup plus brièvement ? La réponse est qu’il s’agissait de rallier à la cause de Jésus de Nazareth, non pas un Éthiopien des origines mais tout un monde judaïsé d’Alexandrie à Bibracte, une diaspora qui ne croyait encore que dans un Jésus, Christ, du ciel dont elle attendait toujours la venue.
http://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-christianisme-est-il-ne-en-141548
Voilà bien l'ironie de l'Histoire ! La Gaule est devenue chrétienne, puis l'Occident, mais dans les sculptures, c'est le visage de Cléopas qu'on a continué à représenter.
Les évangélistes nous ont-ils trompés ?
Bien sûr que non ! On ne peut pas reprocher aux auteurs des évangiles de les avoir écrits dans la forme sous laquelle ils lisaient ou croyaient lire les écrits de leurs pères. Dieu sait à quel point les écrits du prophète Isaïe et des autres ont été passés au crible pour y chercher un message caché annonçant la venue du sauveur.
Tous les Juifs lettrés de cette époque étaient au courant. C'est pour moi une évidence et une certitude. Ils savaient lire le sens caché sous le sens littéral. Quant au petit peuple, on le laissait se satisfaire du sens premier merveilleux s'il le souhaitait. Le problème s'est posé quand la jeune Église a décidé de porter la Parole aux nations. Fallait-il également leur expliquer le sens caché ? Fallait-il apprendre aux Grecs de Jérusalem - qui ne voyaient pas - à voir dans le grande manifestation populaire lancée par Lazare l'accomplissement virtuel de la venue du Jésus annoncé par Isaïe et Zacharie (Jn 12,15, Is 40,9, Zach 9,9) ? http://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/luc-ferry-et-le-cardinal-143809. Quels aveugles avons-nous été, et même jusqu'à ne pas nous rendre compte quand l'évangéliste plaisante sur notre cécité !
Et Paul ? Ne nous a-il pas dit que l’Évangile était recouvert d’un voile ? (2 Co, 4,3) ; un voile qui risque bien de le rester encore longtemps pour les incrédules que nous sommes. N’a-t-il pas dit que Christ vivait en lui (Ga 2, 20), que son plus cher désir était que Christ soit formé en nous (Ga 4, 19), qu’il s’agissait pour nous de revêtir le Christ (Ga 3, 26-38), que nous étions le corps du Christ ou un de ses membres dans l’Église (1 Cor, 12, 27). Qu’on ne s’étonne pas dans ces conditions que les évangélistes aient fait un raccourci en faisant parler directement Jésus plutôt que l’homme inspiré qui lui prêtait sa voix.
Comment expliquer que l’Apôtre des gentils ait également dit qu’était vaine sa prédication et vaine notre foi si le Christ n’était pas ressuscité (1 Co 15, 14) ? Si l’on comprend en esprit, qu'on se rassure ! C'est l'esprit qui ressuscite. La preuve vivante en est que l’esprit de Jésus anime encore aujourd'hui l’Église. S’il faut comprendre dans la lettre, il faut se demander si Paul n’aurait pas été influencé par des témoignages difficiles à vérifier ?
Et pourtant, dans son évangile, Matthieu ne nous laisse-t-il pas entendre que le Fils de l’Homme n’est pas encore venu, puisqu’il nous dit qu’Il viendra (Mt 10, 23 ; 16, 28 ; 24, 27 ; 24, 44 ; 25, 31) ? Il est vrai qu'il a précisé "avant que sa génération ne meurt", ce qui s'est révélé faux.
Y a-t-il aujourd'hui dans notre monde un souci de vérité ?
La France est peut-être, avant son effacement prévisible, le lieu du monde dans lequel on trouve encore la plus forte densité de gens instruits, nourris d'une abondante littérature théologique écrite. Cette phrase sera ma conclusion. Et pourtant.
J'ai 81 ans et le temps se fait court. J'ai vécu mon enfance sous l'occupation. J'ai vu défiler l'armée allemande derrière nos volets clos. Et il m'a fallu attendre le discours de Jacques Chirac pour savoir que l"État français, qui était censé nous protéger, a envoyé à la mort, de sa propre initiative, un nombre important de mes compatriotes. Il est pour moi insupportable qu'une telle vérité n'ait pas été révélée dès l'instant où elle a été connue. Ma profonde conviction, et c'est le devoir de tout citoyen à quelque niveau qu'il soit, est de faire en sorte qu'une vérité soit dite dès qu'elle est connue, aussi douloureuse soit-elle.
J'ai encore sur mon bureau la réponse langue de bois et ô combien hypocrite de Mme Filippetti, ministre de la Culture, à la question écrite 21322 du 19 mars que M. le député Siruge lui a posée concernant l'erreur de localisation du site de Bibracte au mont Beuvray. C'est mon seul et principal obstacle pour faire connaître la vérité et tout ce qui s'ensuit. Et on continue à enterrer l'affaire. Je ne comprends pas.
Alors qu'on pourrait multiplier par deux les revenus du tourisme si on expliquait un peu mieux les origines de notre histoire et la richesse de notre patrimoine, non, vraiment, je ne comprends pas.
E. Mourey, 14 décembre 2013
 Je rappelle ce que j'ai écrit dans mon article précédent : On lit ceci dans les Actes des Apôtres (Act 10, 1-48) : Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italique... suit une vision où un ange lui apparaît pour qu’il invite Simon Pierre à venir le voir. Simon Pierre se trouvait à Joppé. S’ensuit à Césarée une rencontre dont le but est manifestement une tentative de conciliation qui, manifestement, n’a pu se faire qu’avec l’assentiment du roi Agrippa. « Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui, comme nous, ont reçu l’esprit saint ? ». C’est la conclusion de Simon Pierre qui sort de cet entretien avec l’impression d’avoir sinon converti, au moins obtenu une promesse de tolérance.
Je rappelle ce que j'ai écrit dans mon article précédent : On lit ceci dans les Actes des Apôtres (Act 10, 1-48) : Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italique... suit une vision où un ange lui apparaît pour qu’il invite Simon Pierre à venir le voir. Simon Pierre se trouvait à Joppé. S’ensuit à Césarée une rencontre dont le but est manifestement une tentative de conciliation qui, manifestement, n’a pu se faire qu’avec l’assentiment du roi Agrippa. « Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui, comme nous, ont reçu l’esprit saint ? ». C’est la conclusion de Simon Pierre qui sort de cet entretien avec l’impression d’avoir sinon converti, au moins obtenu une promesse de tolérance.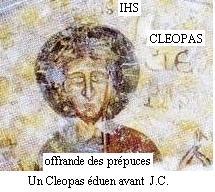 Dans l’évangile de Luc, la conversion de l’Éthiopien a été transposée comme sur un plan supérieur, modifiée et considérablement enrichie. Le personnage de Philippe s’éclipse au second plan tandis que Jésus, qui a rejoint les deux compagnons, se révèle par la fraction du pain. Quant à l’Éthiopien, l'ancêtre des Égyptiens, il devient Cléopas, le messie espéré des fresques de Gourdon, au pied de Bibracte, l’antique et vraie capitale de la Gaule (Lc 24, 13 -33).
Dans l’évangile de Luc, la conversion de l’Éthiopien a été transposée comme sur un plan supérieur, modifiée et considérablement enrichie. Le personnage de Philippe s’éclipse au second plan tandis que Jésus, qui a rejoint les deux compagnons, se révèle par la fraction du pain. Quant à l’Éthiopien, l'ancêtre des Égyptiens, il devient Cléopas, le messie espéré des fresques de Gourdon, au pied de Bibracte, l’antique et vraie capitale de la Gaule (Lc 24, 13 -33).












