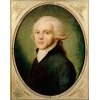Correspondance avec Éric Guéguen
Bonjour,
Suite à une vidéo consacrée à la démocratie[1], Éric Guéguen a posté un commentaire qui a entrainé un long échange par mail. J’ai profité de cette correspondance pour formuler certaines critiques à l’égard de son ouvrage « Le miroir des peuples »[2].
Voici donc la retranscription de cet échange qui intéressera ceux d’entre vous qui trouvent un intérêt à la philosophie politique :
Éric Guéguen :
Bonjour Alban. Toutes nos initiatives sont louables. Même si je ne partage pas tous les points de vue que tu adoptes ici. L'impasse est faite, notamment, sur les problèmes de temps, d'échelle et d'enracinement consubstantiels à l'idée de démocratie.
Alban Dousset :
Sur les points que tu soulèves, si l'on considère la démocratie non pas comme notre système actuel mais bien comme "le pouvoir détenu et exercé par le peuple".
>> Cette conception de la démocratie est très éloignée de notre système actuel, que je perçois essentiellement comme une ploutocratie. Continuer de le désigner comme une "démocratie" (de marché ou libérale ou bourgeoise) me semble absurde.... Ce système est quasiment l'antithèse de la démocratie.
- Sur la question du temps et de l'enracinement : Les systèmes démocratiques les plus « purs » observés sont ceux des sociétés primitives. Ainsi, la fiabilité temporelle (sociétés ancestrales) et l'enracinement culturel (poids considérable des traditions) d'un fonctionnement démocratique m'apparaît comme quasiment optimal.
- Sur la question de l'échelle : La démocratie athénienne (certes moins "pure" que les sociétés primitives) comportait 300 000 individus et 60 000 citoyens. Pour envisager un mode de fonctionnement plus démocratique pour un pays de plus 60 000 000 d'individus, on peut donc imaginer le développement d'une forme de fédéralisme (comme en Suisse) et d'une représentation politique réellement démocratique (basée, par exemple, sur le tirage au sort). Ce dosage du fédéralisme et de la représentation démocratique devraient être déterminés au moment de l'assemblée constituante populaire. De mon point de vue, le problème de l'échelle est moins un problème de dispositif politique qu'une question de possibilité médiatique.
Éric Guéguen :
Ce que je voulais souligner, c'est que revenir à un semblant de démocratie doit amener à repenser les traditions, la "communauté", le lien subi et non choisi, les déterminismes, mais également la liberté engageante, et non seulement la liberté isolante, notre rapport à la consommation, et le TEMPS démocratique, c'est-à-dire la capacité des individus à donner de leur temps au bien commun, de manière bénévole. D'où, petit à petit, mes nombreuses vidéos sur tous ces sujets...
Alban Dousset :
Je suis en train de lire ton livre. Et j'ai l'impression, d'après ce que j'y lis et tes commentaires, que tu as une vision idéaliste de l'histoire. Par "vision idéaliste de l'histoire", j'entends que, pour toi, la trajectoire historique de l'humanité se décide essentiellement par l'histoire des idées, de la spiritualité, des religions, des philosophies et autres théories...
Éric Guéguen :
Le mot "idéaliste" est aussi sujet à ambiguïté que le mot "démocratie". Je comprends ce que tu veux dire au sens où à mes yeux, ce sont en effet les idées qui mènent le monde. Que des gens, aujourd'hui, soient prêts à s'endetter matériellement pour s'offrir un IPad dernier cri me semble aller dans ce sens. Qu'une idée germée dans le cerveau de Steve Jobs puisse aliéner les gens à ce point, au-delà de toutes considérations matérielles, en les amenant à concrétiser, a posteriori, l'idée qu'ils se font du bonheur avec un IPad, c'est fascinant.
Je ne dis pas, bien sûr, que ça me réjouit, mais le libéralisme, justement, triomphe et profite de la vision très matérialiste héritée de Marx et de ses mauvais émules pour s'imposer, non seulement dans les corps, mais avant tout dans les esprits. Autrement, dit, le matérialisme a fait le lit du néolibéralisme. On reparlera de Chouard ensemble une autre fois, si tu le veux bien. C'est un homme qui me semble d'une grande probité et d'une grande générosité. Mais, pour le coup, Chouard est un "idéaliste", cette fois au sens commun du terme : c'est-à-dire un brin naïf, et rétif à certaines lectures qui bousculeraient trop ses convictions.
Et merci, Alban, de lire mon bouquin. N'hésite pas à le déconstruire et à me livrer toutes tes critiques, elles seront les bienvenues. J'ai voulu, non seulement expliquer la genèse de notre situation actuelle, mais aussi tenter de proposer autre chose, ce qui est trop rarement fait (et je n'exclus pas nécessairement le recours au tirage au sort).
Alban Dousset :
Je ne m'étais donc pas trompé sur ta vision historique même si elle est moins explicite dans ton livre que dans "l'empire du moindre mal"... Sur le fond, c'est probablement l'un des reproches essentiel que je ferais à ton ouvrage (mais pas le seul). C'est une question de perspective. Sur cette question de l'idéalisme historique, je vais me permettre de faire un copié/collé de l'essai en économie politique en cours de réalisation :
"Sur le plan philosophique, la doctrine libérale moderne, parfois qualifiée d’ultralibérale, appuie sa légitimité sur des concepts de philosophie politique tels que l’individualisme ou des doctrines politiques tels que le darwinisme social. Jean-Claude Michéa défend l’idée d’une « unité du libéralisme » :
« Je soutiens, en effet, que le mouvement historique qui transforme en profondeur les sociétés modernes doit être fondamentalement compris comme l’accomplissement logique (ou la vérité) du projet philosophique libéral, tel qu’il s’est progressivement défini depuis le XVIIᵉ siècle et, tout particulièrement, depuis la philosophie des Lumières. Cela revient à dire que le monde sans âme du capitalisme contemporain constitue la seule forme historique sous laquelle cette doctrine libérale originelle pouvait se réaliser dans les faits. Il est, en d’autre terme, le libéralisme réellement existant […] aussi bien dans sa version économique (qui a, traditionnellement, la préférence de la « droite ») que dans sa version culturelle et politique (dont la défense est devenue la spécialité de la « gauche » contemporaine et, surtout, de l’« extrême gauche », cette pointe la plus remuante du spectacle moderne). »
Cette thèse, soutenue par Jean-Claude Michéa dans son livre « L’empire du moindre mal », doit être relativisée, pour ne pas dire écartée. Pour cela, il est nécessaire de comprendre que les systèmes politiques et économiques ainsi que les idéologies qui les soutiennent sont à géométrie variable pour les classes dominantes. Selon leurs besoins et leurs stratégies pour canaliser les élans populaires, les classes dominantes habillent leurs oligarchies par des « démocraties représentatives », des « monarchies parlementaires », des « régimes communistes » ou des dictatures assumées.
La démocratie et le libéralisme ne sont que des idéaux nobles qui, servant à légitimer les pires exactions commises par les classes dominantes (« guerre pour la justice ou la démocratie », « servitude volontaire »…), sont dévoyés et corrompus au dernier degré. C’est ici que se noue le drame : quoi de mieux qu’un idéal dévoyé pour justifier son strict contraire : "Notre démocratie libérale est corrompue ? Zut, c’est de la faute du libéralisme et de la démocratie, faisons donc une dictature !"
Ainsi, la responsabilité n’est pas à rechercher dans l’origine ou la nature de nos philosophies politiques mais dans les classes dominantes qui usent de leur pouvoir pour déformer les philosophies politiques, les systèmes politiques (ou leurs appellations) et les systèmes économiques. Lorsque dans les années 80, Reagan et Thatcher deviennent les apôtres du néolibéralisme, ce n’est pas parce qu’ils désirent accomplir la « logique du projet philosophique libéral ». Non, les dominants ne font pas de philosophie, ils dominent. (La philosophie n’est qu’un outil pour asseoir leur domination.) Après avoir constaté que la croissance économique est achevée, la classe dominante décide d’acquérir la maitrise du Capital. Cela se caractérise par une captation des richesses (nouvelles et anciennes) à son profit, c’est-à-dire le profit des oligarchies financières.
Cette captation de richesse est mise en œuvre selon divers moyens évoqués plus haut [libre circulation des capitaux, mise en concurrence internationale des travailleurs, nivellement par le bas des salaires et des droits sociaux, suppression de services publics, suprématie absolue de l'économie, endettement public, paradis fiscaux, fiscalité accommodante pour les haut revenus et les hauts patrimoines…] sous l’étiquette écœurante de « projet global du libéralisme ». Dans la réalité, cette stratégie fut notamment mise en œuvre par Reagan et Thatcher et se traduit dans les propos, d’un extrémisme terrifiant, de Friedrich Von Hayeck :
« Non seulement le concept de justice social est un non sens, mais il est devenu le prétexte par excellence pour liquider les structures du monde libre […] Nous devons [le] combattre [puisqu’il] devient le prétexte à user de la contrainte envers d’autres hommes. […] Concept strictement vide et dénué de sens, il est un signe de l’immaturité de notre esprit. […] L’égalité des chances [est] un idéal totalement illusoire et tout essai de le faire passer dans les réalités risque de créer un cauchemar. […] [Je souhaite faire en sorte que mes contemporains] éprouvent désormais une honte insurmontable à se servir encore des termes « justice sociale »[1] »
Ici, comme souvent, l’idéologie et la philosophie (pour ne pas dire la religion) ne sont que des accessoires et des prétextes pour organiser l’asservissement et justifier un pouvoir. Comment soutenir la thèse de « l’unité du libéralisme » lorsque, comme au Chili, le libéralisme économique devient le prétexte de l’extinction du libéralisme politique ?
« Une dictature peut-être un système nécessaire pour une période transitoire. […] Je préfère sacrifier la démocratie temporairement – je le répète temporairement – plutôt que la liberté. […] Personnellement je préfère un dictateur libéral à un gouvernement démocratique non libéral. »[3]
Dans cet extrait :
- « liberté » est à comprendre comme « ultralibéralisme économique ».
- « temporairement » est à comprendre comme « 17 ans »
- « dictature » est à comprendre comme « régime marqué par de multiples violations des droits de l'homme (plus de 3 200 morts et disparus, plus de 38 000 torturés) »
>> Friedrich Von Hayeck ou comment lutter contre un libéralisme par un autre libéralisme, ou comment démolir le libéralisme politique au motif du libéralisme économique, ou comment la liberté économique est instrumentalisée par les classes dominantes afin de soumettre les classes populaires ou des pays sous le prétexte de « projet global du libéralisme ».
C’est par ce genre de contradiction que l’on peut démasquer l’élasticité, pour ne pas dire l’inconsistance, du terme de « libéralisme ». Comment expliquer la fausse route de Jean-Claude Michéa ? Probablement l’orgueil de l’intellectuel. En effet, il n’y a que des philosophes pour imaginer que la philosophie politique, c’est-à-dire d’autres intellectuels, ont une semblable influence sur le monde. Il n’y a que des intellectuels pour présumer un tel détachement, une telle supériorité de l’esprit sur la matière jusqu’à estimer que l’histoire des idées ne rend compte qu’à elle-même et à ses élites. Cette conception vaporeuse de la philosophie politique libère d’une analyse des rapports de forces interclasse et géopolitique ainsi que d’une prise en compte des mutations médias. N’est-il pas douloureux d’admettre pour nos délicats intellectuels que leur charmante philosophie est une trainée prompte à se vendre, s’offrir, se faire dominer, humilier, salir par les élites dominantes qui maîtrisent la dialectique (comme une arme) ?
C’est un lieu commun de reconnaitre que le libéralisme, qui n’est qu’un mot péjoratif pour désigner la liberté, doit se voir imposer des limites. Néanmoins, épiloguer de la « juste » limite de cette liberté dans le domaine de la morale, du droit, de l’économie, de la politique est un débat philosophique dont la résolution devrait être « réellement démocratique » et non l’affaire de quelques intellectuels à l’esprit étriqué."
Éric Guéguen :
Pour te répondre, partons des conditions parfaites : une communauté d'êtres humains vivant en parfaite harmonie, en parfaite communion de pensée, une communauté où règnerait le plus possible l'amitié la plus parfaite qui puisse être. Il est évident que plus la communauté est étendue, plus ceci tient de l'utopie. Es-tu d'accord avec ça ?
Si oui, afin de pallier les problèmes de mésententes, penses-tu pouvoir faire intervenir un ciment social totalement matériel ? C'était le souhait du communisme qui, s'il a trahi Marx, n'en est pas moins parti de la même prémisse : à savoir que la condition matérielle prime le reste et que le développement intellectuel est accessoire (car dire que c'est une superstructure, c'est dire qu'il est accessoire). Les communistes l'ont pris au mot et, en exagérant quelque peu, l'intellectuel à lunettes est peu à peu devenu traitre à la cause.
Or, l'étude des communautés primitives nous apprend qu'elles tenaient leur harmonie de principes supérieurs, supérieurs parce que spirituels. C'est un fait universel me semble-t-il. Certes, ce n'était pas à proprement parler l'intellect qui dominait, mais l'esprit importait plus que la matière, précisément parce que l'esprit de corps était nécessaire et qu'on ne pouvait l'obtenir par la possession matérielle, par essence exclusive.
Et là où la perversité va loin, c'est que le libéralisme - qui partage avec le marxisme ce présupposé matérialiste - finit par généraliser cette vision du monde au point de réduire les individus à n'être plus que des "prosumers", producteurs-consommateurs. Et nous en sommes là. Ce qui fait dire à des gens comme Michéa et Dany-Robert Dufour (dont je te conseille la lecture) - ce en quoi je suis d'accord - que la pensée de gauche, matérialiste, redistributive, quant elle n'est pas carrément libertaire, est condamnée à être l'idiote utile du capitalisme tout-puissant. On ne fait pas émerger l'ÊTRE collectif, de l'AVOIR, qu'il soit individuel ou collectif. Il faut penser l'être avant l'avoir, d'où le primat des idées. Ou bien, pour reprendre Aristote : les causes matérielles ont beau précéder chronologiquement les causes finales (on s'incarne dans un corps avant de pouvoir penser), elles leur cèdent en importance. Sinon nous ne serions que des animaux comme les autres.
Quant à savoir si c'est le philosophe qui modèle son époque ou si c'est l'inverse, je crois que les deux influences s'entremêlent : il y aurait tout un livre à écrire là-dessus, compliqué au possible. À un moment j'y consacre une demi-page dans le bouquin : il est bien évident que Spinoza ou Machiavel n'auraient pas écrit la même chose s'ils avaient vécu dans un autre pays que le leur, néanmoins leur pensée, comme celle de Marx (le comble !), a profondément imprégné les générations successives et les décisions politiques qui en ont découlé. Je mentionne dans mon avant-propos la volonté - touchante ! - de Marx de se mettre au niveau de compréhension du prolétaire de l'époque... Je ne sais pas si le mec qui me trouve pédant sous ta vidéo a lu Marx, mais il devrait...
Voilà à peu près ce que je voulais te répondre. Merci pour cet échange.
Alban Dousset :
>> "penses-tu pouvoir faire intervenir un ciment social totalement matériel ?"
Absolument pas. Ce n'est d’ailleurs pas ce que j'ai dit.
Pour être précis :
Je reconnais une nécessité pour les communautés de se doter de spiritualité, d'idéaux (moraux, politiques, etc..), théories, philosophies.
Je pense que concevoir une société sans ces éléments "idéalistes" est une terrible erreur. Mais, pour prendre une comparaison, je pense que les éléments idéalistes sont pour une société, comme des vêtements pour individu. Selon les circonstances, ils peuvent s'avérer utiles voire carrément vitaux ou simplement esthétiques.
Ma critique ne porte pas sur ces éléments "idéalistes" en tant que tels mais sur la vision historique qu'ils offrent lorsqu'ils sont considérés comme essentiels, c'est à dire comme une cause majeure, dans l'histoire de l'humanité.
Je ne dis pas non plus qu'ils n'ont pas d'influence, je dis que leurs influences sont relativement mineures vu les causes matérielles pour comprendre (et agir) sur l'histoire.
Tu dis également "principes supérieurs, supérieurs parce que spirituels". Personnellement, je me garde bien d'établir une hiérarchie entre le spirituel et le matériel : une société a besoin des deux.
Comme tu le rappelles dans ton livre, dans l'antiquité grecque, l'excellence était autant valoriser sur le plan physique (donc matériel) que sur le plan spirituel. Ce dont je veux bien convenir c'est que notre société actuelle (comme les diverses société communistes - type URSS) souffrent d'une terrible carence spirituelle.
Enfin, tu dis "On ne fait pas émerger l'ÊTRE collectif, de l'AVOIR, qu'il soit individuel ou collectif." Je t'invite à réfléchir sur cet "ÊTRE collectif".
>> N'a-t-il, selon toi, aucune dimension matérielle dans cet "ÊTRE collectif" ?
On peut définir une société comme : la somme des interactions entre les individus. Or la société (qui répond à la définition que je te donne) correspond à l'aspect "matérialiste" de l'ÊTRE collectif que tu évoques. Pour aller plus loin, c'est la manière dont interagissent les individus qui modifie profondément la société, donc l'ÊTRE collectif. Ainsi, les médias (au sens large et étymologique) conditionnent la manière dont interagissent les individus, donc l'ÊTRE collectif. Donc, l'ÊTRE collectif a des causes matérielles... et ces causes m’apparaissent déterminantes[4].
[N'en déplaise aux idéalistes historiques qui vénèrent les idées sans mesurer leurs faiblesses et leurs limites.]
Enfin, pour le mec qui te trouve pédant[5], je te demande de le pardonner. Pour en avoir été quelque fois la victime (qualifié de pédant), je crois que cette critique relève de l'usage d'un niveau de langage qui est inaccessible à l'interlocuteur et/ou suscite en lui une grande défiance, sinon du mépris. Il s'agit d'une forme de rejet de classe sociale je suppose.
Je comprends la nécessité d'utiliser des termes techniques, précis et un langage soutenu. Néanmoins, il est parfois nécessaire de simplifier le vocabulaire et de garder un langage courant pour rendre certaines idées/concepts accessibles et limpides au plus grand nombre. De plus, cela rend la lecture nettement plus fluide et agréable.
>> C'est justement la principale critique au sujet de la forme que je formulerais à l'égard de ton ouvrage.
Éric Guéguen :
Je te réponds en deux temps.
Tout d'abord, tu admettras, je pense, qu'il est des auteurs qui ont su décrire le système que nous subissons aujourd'hui sans jamais l'avoir vécu. Je pense notamment au courant janséniste et calviniste ayant anticipé notre monde libéral. Face à ce constat, deux possibilités. Ou bien il y a un lien entre leur pensée et notre époque, ou bien il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, ce sont soit des visionnaires, soit des mecs qui ont eu un coup de pot, par pur hasard. Mais s'il y en a un - ce que je crois - ils ont contribué à leur échelle à instiller le changement de cap. Alors, bien entendu, je ne dis pas que tout leur est dû, et je ne dis pas (surtout pas !!) qu'ils n'ont pas également été influencés par leur époque. La porosité se fait dans les deux sens, mais bon... Je pense que certaines grandes idées, issues de certains grands esprits, percolent peu à peu dans la société quelque peu spectatrice à ce niveau.
Deuxième chose : Pour ce qui est du côté "pédant", c'est le lot quotidien des gens issus de la base, comme toi et moi, qui doivent sans cesse faire face à la fois au désintérêt de classe que leur témoigne les gens du sérail, et aux pairs qui, eux, leur demandent de cesser de payer plus haut que leur cul. C'est mon troisième livre. Le premier était un pamphlet qui n'a pas trouvé preneur. Le second était un roman qui n'a pas plu non plus. Et j'ai fini par faire ce que je sais réellement faire : de la philo. Même si j'ai parfois recours à des explications complexes, j'ai cette fois trouvé preneur. Je suis technicien automobile à la base, et je demande simplement à mes lecteurs le même genre d'efforts que j'ai dû moi-même fournir. Et que je continue de fournir. S'émanciper de la tutelle de nos représentants, c'est aussi cela, qu'on le veuille ou non. Je ne pense pas que l'on rétorque fréquemment à Michéa que ses bouquins sont trop difficiles à lire. Et de manière générale, la plupart de ce que je lis est d'un abord plus difficile que ma prose.
Alban Dousset :
J'admets sans réserve qu'il est "des auteurs qui ont su décrire le système que nous subissons aujourd'hui sans jamais l'avoir vécu"...
Outre le courant janséniste et calviniste, on pourrait penser à des auteurs de science-fiction comme Huxley ou Orwell. Néanmoins, tu admettras qu'en matière "d'éléments idéalistes", quelle que soit l'époque, il existe une grande diversité d'orientation spirituelle, idéologique, théorique, philosophique ou d’œuvre de science-fiction...
Mon propos n'est pas de dire qu'il n'y a pas de lien "entre leur pensée et notre époque", mais de dire que ce lien est déterminé (très largement) par l'utilité qu'en ont les classes dominantes.
Cette nécessité peut être le fait de désirer ancrer le pouvoir politique (droit de l'homme...) ou justifier un fonctionnement économique (individualisme Hobbesien ; darwinisme social de Spencer...) ou encore justifier la conquête ou la colonisation (nazisme/sionisme). Pour reprendre l'image des éléments idéalistes pour une société vue comme les vêtements pour individu.
Pour faire du jardinage, dans la vaste garde-robe dont tu disposes, tu opteras plus pour une paire de bottes et une salopette... et non pour des mocassins et un costume.
Pour faire fructifier un patrimoine financier (ce qui est l'intérêt majeur des classes dominantes dans une ploutacratie) tu opteras pour toutes les formes d'idéologie qui contribuent à cet intérêt : annihilation de la spiritualité (sécularisation des religions par la philosophie des lumières) et de l'art (art contemporain) ; neutralisation des disciplines subversives par l'élitisme intellectuel, la complexité sémantique et/ou l’hyper-mathématisation (philosophie, les sciences sociales dont l'économie) ; hyperstimulation des mouvements idéologiques/philosophiques qui servent l'intérêt de la classe dominante (darwinisme social de Spencer ; individualisme Hobbesien ; libre arbitre Cartésien et Sartrien [donc abolition du déterminisme]) ; stimulation des idéologies économiques libérales (école des classiques puis des néoclassiques) ; apologie constante du divertissement, de la superficialité, de la légèreté, du fétichisme de la marchandises, de la réussite individuelle...
Donc, pour synthétiser mon idée, il n'est pas question pour moi de hiérarchiser les éléments idéalistes et matérialistes d'un point de vue d'un idéal philosophique.
En revanche, mes analyses me conduisent à penser que dans une analyse historique, les éléments dits "matérialistes" sont plus déterminants que les éléments dit "idéalistes" (ce qui m'oppose clairement à la vision historique de Michéa) et que la percolation des idées que tu évoques est fortement déterminée par les classes dominantes.
Enfin, pour revenir sur la question de la forme :
D'une part la complexité sémantique visible dans les disciplines subversives est l'un des instruments centraux qui participe à l'abrutissement populaire (ça et les médias de masse). Dans une perspective d'éducation populaire (dont l'objectif serait d'amener le peuple à se regarder en face, dans un miroir...), il m'apparaît fondamental de s'adresser au peuple dans un langage qui lui est intelligible et auquel il ne sera pas hermétique (puisque instinctivement identifié comme celui des classes dominantes...).
J'irai même plus loin, si le peuple est cantonné dans les plaines du divertissement, c'est le rôle de l'intellectuel de le guider vers la montagne de la raison, les sommets de la philosophie autour desquels gravitent des nuages d'idéaux. C'est dans cette transhumance perpétuelle que je conçois le véritable rôle d'un intellectuel dissident. Pour chercher le peuple dans les plaines du divertissement, il faut parfois, pour un temps, mettre de côté sa technicité sémantique et abaissé d'un cran son niveau de langage... sous peine de contribuer à l'élitisme intellectuel et, dans une certaine mesure, à l'abrutissement populaire.
Éric Guéguen :
Pour faire synthétique, j'ai la nette impression que tu utilises systématiquement une grille de lecture dominants/dominés. Chouard fonctionne pareil. Je ne crois pas que ce soit pertinent, surtout à notre époque. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dominés et de dominants... je parle constamment de l'oligarchie au pouvoir. Mais rien de comparable avec l'ancien monde. Autrefois, le consentement n'était pas requis : les masses n'étaient que des masses, et elles-mêmes l'avaient intégré. Aujourd'hui, les "dominants" ont besoin d'un consentement de la part des "dominés", et c'est dans la manière d'obtenir ce consentement qu'ils vont se montrer fourbes. Ça fait toute la différence. Il y a de la servitude volontaire introduite dans l'équation. Comme je le disais ailleurs, les dominés ne le sont que parce qu'ils sont invités à se donner à leurs pulsions, à leurs instincts matériels, à leur envie de consommation. Et ils en redemandent. Le néolibéralisme sait très bien qu'il les tient comme ça.
J'évite également de parler de "totalitarisme" pour parler du néolibéralisme, comme certains le font un peu négligemment, car c'est évacuer la complexité des choses. Le seul élément totalitaire que je perçois - comme dit dans mon livre - c'est celui du nombre. C'est-à-dire ce qui, à nos yeux de petits grouillots, est perçu au contraire comme une délivrance !! C'est un grand paradoxe. Nous sommes dans de l'égo-grégarisme : nous avons l'impression de nous singulariser, mais nous le faisons sans profondeur, en troupeaux, de manière égale. C'est une aubaine pour l'ingénierie sociale, et la matrice de notre impuissance politique. La trouille de ce qui distingue et élève, voire hiérarchise, est le pain quotidien du capitalisme le plus prédateur qui soit.
Un exemple que je prendrai dans une prochaine vidéo : la liberté d'expression. Avant il fallait empêcher la publication de certaines idées. Aujourd'hui il faut au contraire les noyer dans le flux continu d'informations. Le nombre étouffe et ruine toute possibilité de faire émerger des valeurs édifiantes. Tu auras beau tenter d'élever le niveau dans des vidéos en ligne (appelons un chat un chat), on te reprochera toujours de n'être pas assez fun, pas assez ludique vis-à-vis de la concurrence pléthorique qui, elle, offre réellement du divertissement. Tu pourras t'échiner à produire le meilleur contenu possible, il ne trouvera que peu d'écho. Sauf en tablant sur la dichotomie dominants/dominés... ça, c'est vrai que c'est un bon outil marketing. Mais je ne le fais pas car je n'y crois pas. Mais bon, je finirai peut-être par produire une vidéo "vache à lait", où il sera question de Juifs ou de musulmans, car c'est comme ça qu'on attire le chaland. Pas avec une réflexion poussée et originale, fût-elle présentée par des métaphores accessibles à toutes et tous.
Alban Dousset :
Ma compréhension de l'histoire humaine et de la réalité sociale repose sur 4 piliers (dont l'importance est variable selon le contexte) :
- Compréhension des éléments idéalistes.
- Compréhension des rapports de force politiques.
- Compréhension des rapports de force économiques.
- Compréhension des mutations médias.
Ma compréhension du réel me conduit à penser que les rapports de force politiques et économiques se sont progressivement superposés. Cette superposition (qui s'étale sur plus de 300 ans) m'amène à penser que le système politique est, en pratique, détenu par une oligarchie financière. Dans les faits ce système peut être qualifié de ploutocratie. Analyser la réalité sociale du point de vue du rapport dominants/dominés offre l'avantage de prendre en considération le rapport de force politique et économique (2 piliers donc). Je te prie donc de croire que cette grille de lecture n'est pas la seule que j'utilise mais elle permet de discerner l'influence de deux piliers qui se sont lentement superposés.
Cet échange me permet de développer une autre critique de fond que je pourrais adresser à ton ouvrage.
Dans celui-ci, tu sous-entends que l'impasse politique actuelle serait le fait d'une mauvaise alchimie entre la démocratie et l'aristocratie, le nombre et la raison. Cette alchimie conduirait donc à une neutralisation mutuelle du nombre et de la raison, notamment par l'influence nocive du marché.
Attention à ton égo, je me dois d'être sincère pour que tu mesures à quel point je suis en désaccord :
Cette analyse donne vraiment le sentiment d'un philosophe qui entreprends d'analyser un système politique (et ses dysfonctionnements) sans se confronter, à aucun moment, à la réalité.
Le nombre et la raison ont perdu le pouvoir politique réel il y a plusieurs décennies (ou siècle.. tout dépend, la guerre fut longue). Je ne te parle pas du pouvoir théorique, légal, je te parle du POUVOIR RÉEL.
Je crois que cette méconnaissance du réel te conduit à développer des analyses PUREMENT idéalistes qui ne prennent pas en compte certaines perspectives matérialistes telles que les rapports de force économiques et politiques.
Mes propos sont certainement violents : je te prie de n'y voir aucune méchanceté mais uniquement la signification (vigoureuse) de la profonde divergence dans notre analyse du réel.
Afin de combler cette méconnaissance, je t'invite vivement à lire "La guerre de monnaie"[6] qui décrit avec une grande pertinence la main basse du pouvoir économique sur le pouvoir politique.
Contrairement à toi donc, je crois que la grille de lecture dominants/dominés ; 1%/99% ; ne m'a jamais semblé aussi pertinente de nos jours, c'est à dire au moment où les pouvoirs politiques et économiques sont incroyablement concentrés et superposables...
>> Rien de comparable, effectivement, avec l'ancien monde ! [Sans ironie]
Il ne s'agit donc pas d'un "outil marketing" mais d'une dichotomie extrêmement pertinente pour ceux qui s'efforcent de penser le réel.
La question du consentement est factice.
Filons la métaphore, comparons le consentement politique moderne avec, disons, le consentement sexuel d'une jeune fille. Admettons qu'avec une monarchie (ou fascisme ou despotisme éclairé) ce consentement est directement bafoué et la jeune fille violée. Avec des élections, on ne demande pas : « Veux-tu un rapport sexuel et, si oui, avec qui ? » on demande : « Veux-tu un rapport sexuel avec Pierre, Paul ou Jacques ? » Et on ajoute : « Attention, Jacques est un pervers sexuel. » La dessus, pour être sûr que la jeune fille ne se rebiffe pas trop, on l'encourage à consommer des drogues, à ne plus se soucier de religion, on l'abreuve de mensonge au sujet de Pierre et Paul, on fait l’apologie permanente de la sexualité jusqu'à l'ériger en vertu.
>> Ce n'est pas l'idée que je me fais du consentement "libre". Et, dans cette "servitude volontaire", il y a, je le crains, beaucoup, beaucoup plus de servitude que de volonté (libre et éclairée)...
Contrairement à toi, je trouve que la notion de totalitarisme a un sens pour décrire notre réalité. J'explique pourquoi dans l'épisode 6 (consacré l'ingénierie sociale) :
"Un régime totalitaire se distingue d'un régime autoritaire ou d'une dictature dans la mesure où il cherche à contrôler la sphère intime de la pensée en imposant à tous les citoyens l'adhésion à une idéologie en dehors de laquelle ils sont considérés comme des ennemis de la société[7].
En pratique, on peut distinguer deux types de totalitarisme, un totalitarisme masculin et un totalitarisme féminin.
Le totalitarisme masculin "cherche à contrôler la sphère intime de la pensée et à imposer une idéologie" sur un style paternel en usant d'autorité et en générant de la peur. Le totalitarisme masculin produit et impose une pensée conforme contre laquelle on peut s'affranchir dans son intimité.
Le totalitarisme féminin "cherche à contrôler la sphère intime de la pensée et à imposer une idéologie" sur un style maternel usant d’une forme de séduction et de manipulation. Le totalitarisme féminin produit et impose un cadre de pensée conforme qui incarne à la fois une pensée dominante et une pensée contestataire qui écartent, dans leur dialectique, les questionnements et les arguments jugés non conformes."
Pour commenter brièvement ton dernier paragraphe, l'objectif de mes vidéos est d'offrir des synthèses complètes et sourcées, dans un langage accessible, avec une réalisation pédagogique. Rien de plus.
Je te prie de croire que le choix de mes sujets correspond réellement à mes intérêts personnels.
Éric Guéguen :
Tout d’abord, sache que je ne prends pas du tout mal la critique. Et c’est un vieux débat que j’ai avec un agoravoxien, lecteur de Machiavel et de Marx qui, lui aussi, focalise sur les rapports de force. Et ces rapports de force, à aucun moment je ne les nie. Seulement on a changé de paradigme. Pour dire les choses clairement, je dirais ceci (et c’est encore une fois la formule que j’emploierai dans une prochaine vidéo sur le relativisme culturel) :
Le grand cadeau de la modernité, c’est la massification. C’est quelque chose d’inédit dans l’histoire : nous vivons à l’ère des masses, pour le meilleur… et pour le pire, on oublie trop souvent de le mentionner. De fait, nous avons tendance à voir dans la massification un soulagement, la promesse d’un monde sans classes, d’un amas d’individus indistincts si ce n’est du point de vue des goûts superficiels.
Eh bien ce que je fais dans la partie consacrée à l’ « empire du nombre » (que tu as lue), c’est expliciter en quoi la massification est aussi le formidable outil de notre impuissance politique. Et ce que nous appelons oligarchie, qui existe réellement, s’appuie là-dessus. Je veux dire qu’elle [l’oligarchie] a parfaitement conscience du fait que la massification soit pour nous ET un élément rassurant, ET un élément paralysant. Et c’est une aubaine !!! Nous sommes demandeurs de ce qui nous paralyse !!! D'où l'image que j'emploie à la fin du livre 2 de la main du capitalisme qui meut le gant démocratique.
C’est absolument génial, et les pires dictateurs des temps poussiéreux n’auraient jamais pensé à un truc pareil. L’oligarchie de notre époque est particulière en ceci qu’elle s’appuie sur l’ochlocratie, un concept bien moins en vogue que la ploutocratie, mais néanmoins tout à fait pertinent. Et si je prône un régime hybride entre aristocratie et démocratie (que j'appelle démocratie "ordinale" et avec laquelle tu vas bientôt faire connaissance dans mon bouquin), c’est précisément parce que je veux inviter la première à contrer l’ochlocratie, et la seconde à contrer l’oligarchie. Et je le fais en prenant des exemples concrets : tu le verras en finissant la lecture.
Maintenant, j’aimerais répondre en deux temps au fait que tu me trouves « idéaliste ».
D’abord par un exemple historique : le capitalisme aurait pu germer dès le XIIe ou le XIIIe siècle, il était prêt, dans les cartons, mais ça ne s’est pas produit. Pourquoi ? Parce qu’une chape de plomb morale – donc des idées… – l’en empêchait. Il aura fallu attendre que la bourgeoisie, notamment anglo-saxonne, foute en l’air le christianisme pour débrider l’élan marchand. Il me semble que ce qui te rebute dans le fait que les idées puissent mener le monde (cf. mon exemple de l’IPAD), c’est qu’elles émergent de cerveaux géniaux et isolés, qui se distinguent donc du commun des mortels. Ce qui m’amène à la suite...
Je perçois dans ta lecture du monde moderne et contemporain un attachement à une idée bien précise, de sorte que tu me parais être le plus « idéaliste » de nous deux. Cette idée, c’est l’ « égalité » en tant qu’elle serait vouée à advenir tôt ou tard de la manière la plus étendue possible (Chouard, une fois de plus, a le même biais, d'où sa lecture dominants/dominés obsessionnelle). Nombreux sont les gens à être « esclaves » de l’idée d’égalité, à la pronostiquer en toutes choses. Partant de là, il leur est bien difficile de comprendre ce paradoxe : qu’un attachement excessif à l’idée d’égalité puisse engendrer… les pires inégalités qui soient !! Tu ne vas pas tarder à lire ce que je dis de la justice vis-à-vis de l’égalité (Aristote), et de l’exemple on ne peut plus concret que je prends avec l’Éducation nationale. J’espère que tu rebondiras là-dessus également. ;-)
Alban Dousset :
Je suis globalement d'accord avec le phénomène idéologique que tu décris (massification...) et son influence social. Je n'y reviens donc pas.
Sur les deux points que tu développes :
Tu évoques brièvement la naissance du capitalisme (et avant lui des lumières)... D'une part je ne nie pas l'influence que peuvent avoir les idées sur le réel néanmoins, je pense que la sécularisation du christianisme/guerre de religion, l'essor des sciences, le renouveau philosophique, la virulente critique de la monarchie. C'est à dire le contexte social qui a conduit à la révolution et l'avènement du capitalisme... Tout cela est étroitement lié à une invention qui va radicalement changer la société : l'apparition de l'imprimerie (et avec elle, l'impression des bibles, des recherches scientifiques, des essais philosophiques, des pamphlets antimonarchiques...)
Contrairement à l'idée que tu te fais de moi, je ne suis pas un "acharné de l'égalité". Je trouve que l'objectif d'égalité politique pour repenser notre système politique est intéressant. Mais cela ne signifie pas nécessairement que je suis contre une dose aristocratique dans le système politique de demain... Au contraire. Personnellement, je pense que des constituants tirés au sort trouveraient d'eux même un équilibre adéquat entre démocratie et aristocratie. En matière politique, je ne me suis jamais penché sur un "système politique idéal".
Mes travaux portent sur l'économie politique. En la matière, j'ai très peu été guidé par l'égalité. Les principes qui sous-tendent mes préconisations sont l'équilibre et la justice sociale.
Éric Guéguen :
Pour moi, je le dis et l'explique abondamment dans mon livre, la "justice sociale" est l'autre nom du désir d'égalité. Hayek - que je n'apprécie pas particulièrement - l'a d'ailleurs bien senti. La justice est un mot qui se suffit à soi seul. Lui accoler le mot "sociale" est à mes yeux un sophisme.
[1] Le lien vers ma vidéo consacrée à la démocratie : https://www.youtube.com/watch?v=r5T6Fag06N4
[2] Le lien vers le miroir des peuples : http://cerclearistote.com/parution-de-louvrage-deric-gueguen-le-miroir-des-peuples/
[3] Friedrich Von Hayeck , avril 1981, interview au journal Chilien « El Mercurio ».
[4] Cf à l'épisode 6 de ma chronique : http://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/chronique-d-un-eveil-citoyen-154164)
[5] Référence à un commentaire Youtube relativement agressif qui reprochait notamment à Éric Guéguens d’être pédant.
103 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON